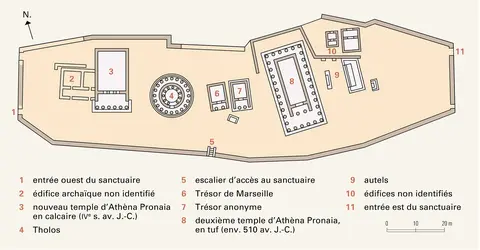DELPHES
La Pythie et le sanctuaire
Delphes est un lieu mythique. Le réel – paysage, édifices, événements – y revêt plus qu'ailleurs la valeur de symbole, de parade théologique. Tout objet, toute portion nommée de l'espace appelle un regard désireux de connaître non seulement un repérage factuel, mais aussi et surtout la manière dont un dieu, avec ou malgré d'autres dieux, a été censé habiter un microcosme à l'image de ses puissances. Certes, circule depuis l'Antiquité une vision désenchantée du site. Centre oraculaire puissant et accessible à la corruption pour Hérodote, endroit caractérisé par des qualités géographiques et géologiques pour Strabon, Delphes a pu ne représenter que cela pour certains. Un sanctuaire savamment géré par une caste sacerdotale avertie et « laïque », un lieu où des exhalaisons s'échappant d'une fente du sol provoquaient – ou le faisaient croire – un état second chez la prêtresse chargée de délivrer des messages divinatoires. À leur tour, bien des historiens modernes et contemporains de Delphes ont choisi de souscrire à une représentation matérialiste. Si Jean Defradas reconstruit ce qu'il appelle la « propagande » delphique, à savoir tous les thèmes d'une auto-représentation mensongère et politiquement intéressée de la part des prêtres delphiens, Pierre Amandry a pu congédier toute la tradition concernant le délire de la Pythie et la dimension mystérieuse et rituelle de l'énonciation oraculaire, pour rétablir la vraisemblance d'un service mantique routinier et raisonnable. Pour les modernes a certainement joué la découverte, lors de la fouille menée en 1892 à Delphes par l'École française d'Athènes, que les soubassements du temple d'Apollon ne présentaient aucune trace d'une fissure naturelle. Davantage : que, étant donné la qualité géologique du lieu (schiste mou), aucun type d'exhalaison n'aurait pu s'y produire.
Et, cependant, à l'encontre de la nature et de la plausibilité historiques, toute une tradition ancienne parle de l' oracle de Delphes en d'autres termes. Son centre vital, ce ne sont pas des prêtres avides, mais une prêtresse inspirée, possédée par le dieu véridique. Au plus secret du temple d'Apollon, siégeant dans la cuve d'un grand trépied, la Pythie répond aux questions que lui posent des consultants venus de l'ensemble du monde habité. De cette tradition, il convient d'abord de donner un aperçu.
Une prophétesse inspirée
Géographe et « ethnologue » peu complaisant à l'égard du merveilleux, Strabon écrit : « On dit que le siège de l'oracle est un trou qui s'enfonce profondément dans le sol et dont l'ouverture n'est pas très large ; il en sort un souffle inspirateur ; au-dessus de l'ouverture est placé un haut trépied, sur lequel monte la Pythie ; elle reçoit le souffle et rend les oracles en vers et en prose » (IX, 3, 5). Pausanias, visiteur attentif du site, lui fait écho ; le lieu mantique a été découvert par des bergers rendus « inspirés » par des vapeurs auxquelles ils s'étaient trouvés exposés par hasard et grâce auxquelles ils s'étaient mis à rendre des prophéties au nom d'Apollon (X, 5, 7). Version recueillie sur place auprès des Delphiens, et que rapporte abondamment Diodore de Sicile, lorsqu'il raconte comment des chèvres d'abord, des bergers ensuite firent l'expérience d'un soudain délire prophétique qui saisissait quiconque s'approchait d'un trou de la terre. Non maîtrisée, cette fureur clairvoyante mais dangereuse poussait nombre de gens au suicide, à se jeter dans le trou même d'où émanait le pouvoir de dire l'avenir. C'est ainsi que « les habitants du voisinage, pour écarter tout danger, nommèrent une femme seule prophétesse pour tous, et la consultation eut lieu désormais[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Bernard HOLTZMANN : ancien membre de l'École française d'Athènes, professeur émérite d'archéologie grecque à l'université de Paris-X-Nanterre
- Giulia SISSA : chercheur au C.N.R.S.
Classification
Pour citer cet article
Bernard HOLTZMANN et Giulia SISSA. DELPHES [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
ANTÉNOR (fin VIe s. av. J.-C.)
- Écrit par Bernard HOLTZMANN
- 348 mots
Sculpteur athénien, auteur d'un groupe en bronze représentant les « Tyrannoctones », Harmodios et Aristogiton, assassins du tyran Hipparque en ~ 514, et promus héros de la liberté par la démocratie naissante (Pausanias, I, 8, 5). Ce groupe, postérieur à 508 avant J.-C., fut emporté comme butin par...
-
APOLLON, mythologie grecque
- Écrit par Robert DAVREU
- 798 mots
- 1 média
Expression la plus haute et la plus achevée de ce que fut le génie grec, Apollon apparaît, avant même la période classique, comme un dieu proprement hellène. En lui, toute trace d'une origine asiatique, si sensible chez d'autres divinités, Dionysos notamment, a été estompée, et ce dès avant les...
-
ÉCOLE FRANÇAISE D'ATHÈNES
- Écrit par Olivier PICARD
- 2 040 mots
Fondée dans le grand élan de philhellénisme qui accompagna la libération de la Grèce du joug ottoman, « l'École française de perfectionnement pour l'étude de la langue, de l'histoire, des antiquités grecques » (ordonnance royale de 1846), le plus ancien établissement scientifique à l'étranger et le...
-
GRÈCE ANTIQUE (Civilisation) - La religion grecque
- Écrit par André-Jean FESTUGIÈRE, Pierre LÉVÊQUE
- 20 084 mots
- 8 médias
...d'un individu. Le dieu oraculaire par excellence est Apollon, qui a dépossédé, dans plusieurs de ses sanctuaires, notamment à Claros (Asie Mineure) et à Delphes, de vieilles divinités chthoniennes, dépositaires avant lui de ces pouvoirs. L'habileté du clergé delphique fut de donner, à partir de la fin du... - Afficher les 17 références
Voir aussi
- GROUPE, sculpture
- TRÉSOR, Grèce antique
- CHRYSÉLÉPHANTINE SCULPTURE
- FOUILLES, archéologie
- PIERRE, architecture
- GRECQUE RELIGION
- EX-VOTO
- PYTHIE
- OFFRANDE
- TEMPLE, Grèce antique
- GRÈCE, histoire, Antiquité
- DEVIN
- GRECQUE MYTHOLOGIE
- FEMME IMAGE DE LA
- GRECQUE SCULPTURE
- GRECQUE ARCHITECTURE
- GRECQUE PEINTURE
- ANTIQUITÉ, sculpture
- ANTIQUITÉ, architecture
- OMPHALOS
- PARNASSE MASSIF DU
- AMANDRY PIERRE (1912-2006)
- SANCTUAIRE
- ARCHITECTURE RELIGIEUSE