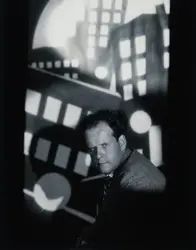RUSSE CINÉMA
Le cinéma soviétique naît officiellement du décret de nationalisation signé par Lénine le 27 août 1919. Pendant soixante-dix ans, ce cinéma va être affaire d'État, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur : par l'indifférence à peu près constante aux questions de rentabilité, qui en fait un cas unique, ouvert à de très nombreuses expérimentations. Pour le pire : par la soumission de la production et de la création aux décisions politiques, des plus fondamentales aux plus futiles. Dans une situation de contrôle aussi rigide, il est remarquable que, pendant de longues périodes, des cinéastes aient réussi à maintenir leur indépendance et leur rigueur, et à poursuivre leur travail comme ils l'entendaient. Les moments où le cinéma est en phase avec l'histoire du pays et en témoigne, serait-ce à travers diverses médiations et seconds degrés, sont plus nombreux que ceux qui dénotent un étouffement complet.
Un cinéma révolutionnaire
Les commencements : rupture et continuité
Le cinéma ne naît pas du décret de Lénine. Il était déjà une industrie prospère sous le tsar. Un système de production et un réseau de salles se sont créés. Plus encore, divers pionniers en ont pressenti les possibilités artistiques : Piotr Tchardynine, le réalisateur de films d'animation Ladislas Starévitch, Iakov Protazanov, Evguéni Bauer surtout, qui fait du symbolisme un style cinématographique. Même les avant-gardes avaient pied dans le cinéma prérévolutionnaire : le metteur en scène Vsevolod Meyerhold, grand rival de Stanislavski, avait réalisé deux films avant de lancer l'« Octobre théâtral », et le poète futuriste Vladimir Maïakovski avait écrit et interprété plusieurs films en 1918, mais pour des firmes privées traditionnelles.
La révolution chasse bon nombre de techniciens et d'acteurs, d'abord en Crimée, où ils avaient l'habitude de tourner leurs extérieurs, puis à travers l'Europe, dans une émigration qui les mènera jusqu'aux centres de production : Berlin, Paris, Londres. L'infrastructure industrielle est en grande partie détruite par la guerre civile. Mais ceux qui fondent le cinéma soviétique, dans les plus grandes difficultés, assurent une continuité autant qu'ils opèrent une rupture. Lev Koulechov est le décorateur et élève de Bauer, mort de la grippe espagnole. Le vétéran Vladimir Gardine fonde la première école de cinéma à Moscou. Iakov Protazanov revient en 1923 de son émigration en France et en Allemagne, et assure jusqu'au début des années 1940 la continuité d'un cinéma traditionnel de haute qualité.
Les avant-gardes
Il n'en reste pas moins que le cinéma soviétique a été créé par des enfants terribles : de jeunes artistes d'avant-garde, soutiens enthousiastes de la révolution, souvent inspirés par le mouvement futuriste, ralliés autour de Meyerhold, de Maïakovski et du groupe « formaliste » LeL (front gauche de l'art), sous la protection du ministre de l'Éducation Anatoli Lounatcharski, lui-même plus conservateur en matière d'art et scénariste occasionnel : Cohabitation, dès 1918, aborde un conflit essentiel du jour, le logement. Les revues L'Art de la commune puis Kinophot rassemblent les artistes de gauche et les théoriciens « formalistes ». Lef publie dès son numéro 3 Le Montage des attractions, de Serge Mikhailovitch Eisenstein, et Kinoks Révolution, de Dziga Vertov. Ce poète futuriste de Byalistok, comme Koulechov pionnier des actualités pendant la guerre civile, rêve de reconstruire le monde avec la nouvelle technique du cinéma.
Les premiers films d'agitation sont liés à la guerre civile et visent à la fois à populariser la politique du nouvel État et à lutter contre les vieilles idées. Dziga Vertov révolutionne les actualités en les articulant par des intertitres fournissant des[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Bernard EISENSCHITZ : traducteur, historien du cinéma
Classification
Pour citer cet article
Bernard EISENSCHITZ. RUSSE CINÉMA [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Voir aussi
- LEF, mouvement artistique soviétique
- DOCUMENTAIRE CINÉMA
- CINÉMA D'AVANT-GARDE
- KOULECHOV LEV VLADIMIROVITCH (1899-1970)
- DÉGEL, URSS
- TCHIAOURELLI MIKHAÏL EDICHEROVITCH (1894-1974)
- STALINISME
- CINÉMA THÉORIES DU
- COMMUNISME DE GUERRE
- PROTAZANOV YAKOV (1881-1945)
- BARNET BORIS (1902-1965)
- ROOM ABRAM (1894-1976)
- ERMLER FRIEDRICH (1898-1967)
- KALATOZOV MIKHAÏL (1903-1973)
- ROOM MIKHAÏL (1901-1971)
- MIKHALKOV NIKITA (1945- )
- NORSTEIN IOURI (1941- )
- SOVIÉTIQUE CINÉMA
- KHOUTSIEV ou KOUTZIEV MARLEN (1925-2019)
- MIKAELIAN SERGUEÏ (1923-2016)
- PANFILOV GLEB (1933-2023)
- IOSSELIANI OTAR (1934-2023)
- MIKHALKOV-KONTCHALOVSKI ANDREÏ (1937- )
- CHENGUELAÏA GUEORGUI (1937- )
- CINÉMA MUET
- CINÉMA HISTOIRE DU
- MOSJOUKINE IVAN (1889-1939)
- TRAUBERG LEONID (1902-1990)
- MONTAGE, cinéma
- YOUTKÉVITCH SERGE (1904-1985)
- ACTUALITÉS ou PRESSE FILMÉE
- UKRAINIEN CINÉMA