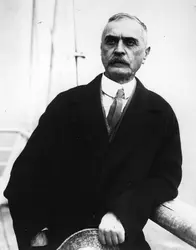SANG Vue d'ensemble
Le sang est un tissu « liquide » présent uniquement chez les animaux supérieurs et chez plusieurs invertébrés. Comme l'épithélium, le muscle ou l'os, il est formé de cellules vivantes ; cependant, celles-ci sont en suspension dans une solution aqueuse de composition complexe. En outre, grâce à sa circulation, le sang remplit de multiples fonctions nécessaires à la vie, telles que les échanges respiratoires et nutritifs, la régulation de la constance du milieu intérieur, la répartition et l'égalisation de la chaleur, et la défense de l'organisme.
Ce rôle vital du sang a été compris dès la préhistoire. Pourtant, les découvertes en hématologie, lentes et longtemps demeurées dans l'ombre, sont l'œuvre de chercheurs isolés et écrasés par les contraintes de la tradition et de la religion. On peut les grouper schématiquement en trois périodes. La première débute dès 1616, lorsque Harvey démontre le mouvement circulaire perpétuel du sang. Peu après, Lower observe que le sang qui va au poumon est noir, tandis qu'« imbibé d'air » il est de nouveau rutilant dans la veine pulmonaire. Ce n'est qu'en 1867 que H. Selye explique ce phénomène, ainsi que la propriété des globules rouges de capter et de relâcher l'oxygène. En 1674, les observations au microscope remarquablement précises du Hollandais Leeuwenhoek permettent de donner une bonne approximation du diamètre moyen des globules rouges (1/3 000 d'inch, soit 8,5 μm) ; elles sont toutefois niées ou méconnues jusqu'au milieu du xixe siècle. La deuxième période s'ouvre avec la découverte, en 1901, des groupes sanguins A, B, O par Landsteiner, d'où dériveront les connaissances actuelles sur l'immuno-hématologie. Par la suite, on a pu préciser la structure des immunoglobulines, étudier le contrôle génétique de la synthèse des protéines et rendre réalisables des applications thérapeutiques, telles que la transfusion sanguine entre sujets de même groupe et les greffes d'organes moyennant l'histocompatibilité (Jean Dausset) des tissus du donneur avec ceux du receveur. Enfin, la troisième période a été ouverte par l'apport de techniques nouvelles, telles que la microscopie électronique et l'utilisation des traceurs radioactifs. L'hématologie s'est ainsi enrichie en utilisant les techniques de la physique, de la biochimie, de l'immunologie, de la génétique, de la pharmacologie.
Durant les dernières décennies, l'hématologie s'est scindée en secteurs qui se développent aujourd'hui quasi indépendamment les uns des autres. Notre propos ici sera donc d'envisager tour à tour le sang lui-même (hématologie), puis sa formation (hématopoïèse), son écoulement (hémorhéologie), sa coagulation (hémostase), et enfin les marques génétiques (hémotypologie) dont il est porteur. Il sera inévitable, ce faisant, de renvoyer le lecteur à de nombreux articles spécifiques qui compléteront ce que le présent ensemble s'est donné pour objectif d'esquisser.
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Alain COSSON : docteur en médecine, assistant de biologie à la faculté Necker-Enfants malades
Classification
Pour citer cet article
Alain COSSON. SANG - Vue d'ensemble [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
ACIDO-BASIQUE ÉQUILIBRE
- Écrit par Pierre KAMOUN
- 2 955 mots
- 1 média
C'est en 1922 que Van Slyke pose les premiers principes de l'équilibre acido-basique, en reprenant la définition du pH fournie en 1909 par Sœrensen (logarithme de l'inverse de la concentration en ions hydrogène). Il montre la constance de ce pH dans le milieu intérieur. Seules...
-
AÉRO-EMBOLISME
- Écrit par Didier LAVERGNE
- 82 mots
Formation dans le sang de bulles gazeuses qui provoquent des troubles circulatoires aux conséquences variées, parfois très graves (coma irréversible). Ce phénomène est dû au brusque passage à l'état gazeux des gaz dissous dans le sang (azote surtout) ; il se produit à l'occasion de décompressions...
-
ANÉMIES
- Écrit par Bruno VARET
- 3 091 mots
- 5 médias
L' anémie est souvent identifiée à la pâleur. Cette notion populaire correspond à une donnée physiologique : les globules rouges contiennent un pigment de coloration rouge, l' hémoglobine. Ce pigment, rouge comme la couleur du sang qui s'écoule d'une blessure, participe à la coloration...
-
AZOTÉMIE
- Écrit par Geneviève DI COSTANZO
- 424 mots
L'élévation dans le sang du taux de l'urée et des autres produits d'excrétion azotée est communément décrite en clinique sous le nom d'azotémie ou d'urémie. Elle représente le stade terminal de l'insuffisance rénale progressive et résulte de l'impossibilité d'excréter les...
- Afficher les 53 références