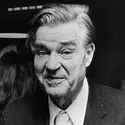MACROÉCONOMIE Politique économique
Les politiques structurelles
La France a connu à partir de la fin des années 1970 une croissance molle et un taux de chômage élevé. Faut-il y voir les conséquences d'un réglage conjoncturel déficient ? Les exigences de la construction monétaire européenne auraient imposé une politique de rigueur trop accentuée et fini par engendrer une faiblesse structurelle de la demande. La comparaison avec les expériences plus réussies de ses partenaires européens amène pourtant à douter que ce puisse être la cause principale des difficultés françaises. Il est nécessaire, en tout cas, d'examiner les problèmes de fond dont souffre l'économie et de proposer des politiques structurelles destinées à y remédier. Les principales sont les politiques d'emploi et les politiques de croissance.
Les premières visent à diminuer le taux de chômage naturel, c'est-à-dire le taux de chômage d'équilibre autour duquel gravite le taux effectif. On sait depuis longtemps que des rigidités, comme l'existence d'un salaire minimum, peuvent expliquer le caractère trop élevé du taux naturel. Mais les analyses du marché du travail menées depuis les années 1980 prennent beaucoup mieux en compte sa complexité. Elles mettent l'accent sur l'hétérogénéité, à la fois catégorielle et individuelle, des travailleurs ; la recherche d'emploi et les problèmes d'appariement ; le rôle éventuellement désincitatif, mais évidemment nécessaire, de la fiscalité et de l'indemnisation. Les politiques d'emploi destinées à redynamiser le marché du travail prennent donc des formes précises, allant au-delà de la simple volonté de flexibilisation du marché. La redéfinition du contrat de travail, les subventions à l'emploi des travailleurs non qualifiés, la prime pour l'emploi destinée à encourager la reprise d'activité, les politiques actives d'accompagnement des chômeurs, le couplage entre amélioration de l'indemnisation et obligation d'accepter les propositions d'emploi sont les principales orientations. La réduction de la durée légale hebdomadaire du temps de travail à trente-cinq heures a aussi été mise en œuvre pour contribuer à réduire le chômage, mais sa logique peut être fortement contestée. Dans tous les cas, les effets de ces politiques doivent être analysés, mesurés et rapportés à leurs coûts. L'évaluation des politiques publiques est de plus en plus considérée comme une nécessité.
Les politiques de croissance cherchent à augmenter le taux de croissance tendanciel de l'économie. En phase avec les nouvelles théories de la croissance endogène, elles mettent l'accent sur la recherche-développement et la formation supérieure. L'agenda de Lisbonne, adopté en 2000 par l'Union européenne leur offre un cadre général et des objectifs ambitieux. Le pourcentage du P.I.B. consacré à la recherche devrait atteindre 3 p. 100 en 2010, contre 1,9 p. 100 en 2000, et les deux tiers de ces dépenses devraient être réalisées dans les entreprises elles-mêmes. L'accumulation de capital humain, à travers l'amélioration de l'enseignement supérieur, apparaît aussi comme une nécessité pour maintenir l'Europe à la frontière de l'innovation. L'environnement légal de l'innovation, enfin, est un facteur clé. Quel compromis faut-il trouver entre la défense de la propriété intellectuelle, nécessaire pour assurer à la recherche une rémunération suffisamment incitative, et la volonté de maintenir une concurrence suffisante et la possibilité pour de nouveaux entrants de prendre pied dans les domaines porteurs ? Ces politiques de la concurrence et de l'innovation sont maintenant conçues au niveau européen. Elles nous ramènent aux questions d'allocation des ressources. L'imbrication des trois objectifs de Musgrave est bien au cœur des politiques macroéconomiques[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Antoine d' AUTUME : professeur de sciences économiques à l'université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne
Classification
Pour citer cet article
Antoine d' AUTUME. MACROÉCONOMIE - Politique économique [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Autres références
-
AGRÉGAT ÉCONOMIQUE
- Écrit par Marc PÉNIN
- 1 488 mots
Au sens premier, un agrégat est un assemblage de parties qui forment un tout. Dans le vocabulaire économique moderne, le mot désigne une grandeur caractéristique de l'économie nationale et, plus généralement, une grandeur globale synthétique représentative d'un ensemble de grandeurs particulières. Le...
-
ANTICIPATIONS, économie
- Écrit par Christian de BOISSIEU
- 6 072 mots
- 4 médias
Puisque les variables macroéconomiques résultent de la conjugaison des actions individuelles, elles sont également conditionnées par les prévisions. Donnons quelques exemples : -
CAPITAL
- Écrit par Ozgur GUN
- 1 387 mots
Cette façon de concevoir la société est, en partie, sous-jacente dans les représentations actuelles de ce que les économistes appellent la macroéconomie, lorsqu'ils considèrent que le produit national est obtenu à partir du capital et du travail. Mais à la vision d'une lutte pour le partage du produit... -
CHÔMAGE - Politiques de l'emploi
- Écrit par Christine ERHEL
- 7 302 mots
- 2 médias
Les évaluations macroéconomiques mesurent l'impact des politiques de l'emploi sur l'emploi, le chômage, les salaires, ou encore sur les flux sur le marché du travail, au niveau global. Elles utilisent des données agrégées, et éventuellement des modèles macroéconométriques existants. - Afficher les 27 références
Voir aussi
- ÉCONOMIE DE MARCHÉ
- FLUCTUATIONS ÉCONOMIQUES
- AGENTS ÉCONOMIQUES
- BALANCE COMMERCIALE
- MODÈLES ET MODÉLISATION, économie
- IS-LM MODÈLE, économie
- KEYNÉSIANISME
- INÉGALITÉS ÉCONOMIQUES
- ÉCONOMIE PUBLIQUE
- EUROPE, politique et économie
- PHILLIPS COURBE DE
- TAYLOR JOHN B. (1946- )
- MARCHÉ DU TRAVAIL
- POLITIQUE MONÉTAIRE
- POLITIQUE ÉCONOMIQUE
- REDISTRIBUTION, économie
- SERVICE PUBLIC
- CONSOMMATEUR COMPORTEMENT DU
- CROISSANCE ÉCONOMIQUE
- PROCESSUS CUMULATIF, économie
- OFFRE & DEMANDE
- MONÉTARISME
- FRANCE, économie
- CONJONCTURELLE POLITIQUE
- POLITIQUE FISCALE
- POLITIQUE BUDGÉTAIRE
- EMPLOI POLITIQUES DE L'
- ALLOCATION DES RESSOURCES