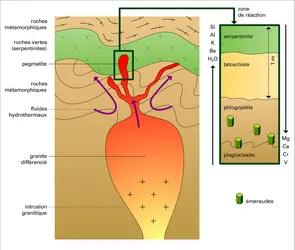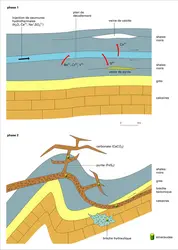ÉMERAUDE
Les imitations et les émeraudes synthétiques
En raison de sa valeur, l'émeraude fait l'objet de nombreuses imitations réalisées avec des matériaux divers, à commencer par le verre. En général, ce sont des doublets dont la couronne est taillée dans un minéral clair – cristal de roche, béryl incolore ou émeraude claire de moindre qualité – et la culasse faite d'une pâte vert émeraude ou d'un verre. D'autres doublets sont constitués de deux lames de cristal de roche collées par un ciment vert, la lame de quartz inférieure pouvant présenter des givres afin d'imiter le jardin de l'émeraude. Il existe aussi des doublets aigue-marine claire – ciment vert – tourmaline givreuse, que les marchands colombiens proposent aux touristes sous l'appellation d'« émeraudes semi-précieuses ». Tous ces types de doublets sont parfois difficiles à reconnaître, surtout s'ils sont déjà montés et sertis.
Les premières émeraudes synthétiques furent produites en 1848, par le Français Jacques Joseph Ebelmen alors directeur de la Manufacture de Sèvres, en utilisant le procédé de dissolution anhydre : cristallisation à la pression normale d'une solution de silicates dissous par attaque basique et saturée par les éléments nécessaires à la constitution des émeraudes. Les cristaux obtenus par Ebelmen étaient petits ; l'amélioration du procédé au début du xxe siècle permit la synthèse de pierres de taille centimétrique, mais il fallut attendre le début des années 1950 pour que l'émeraude synthétique connaisse un réel essor industriel, grâce aux travaux de Caroll chathman, qui améliora la méthode d'Ebelmen à partir d'un sel alcalin fondu à sec. Au début des années 1960, la société leichleitner réussit à fabriquer des émeraudes par le procédé de cristallisation par dissolution hydrothermale, déjà utilisé pour le quartz et le rubis. Cette méthode consiste à enrober un noyau d'aigue-marine ou de béryl synthétique d'une solution hydrothermale, enrichie des éléments adéquats, qui cristallise l'émeraude.
Aujourd'hui, les émeraudes synthétiques sont issues de ces deux techniques, la fabrication par dissolution anhydre étant la plus utilisée. Elles trouvent une destination commerciale vers la joaillerie car elles présentent des défauts, un « jardin », comme les pierres naturelles ; elles se distinguent en cela des rubis et des saphirs synthétiques, dont la pureté les trahit et les destine plutôt à des usages industriels. Les émeraudes synthétiques se distinguent toutefois des pierres naturelles par une densité légèrement plus faible (de 2,65 à 2,71) et des indices de réfraction moindres.
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Yves GAUTIER
: docteur en sciences de la Terre, concepteur de la collection
La Science au présent à la demande et sous la direction d'Encyclopædia Universalis, rédacteur en chef de 1997 à 2015
Classification
Pour citer cet article
Yves GAUTIER. ÉMERAUDE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
BÉRYL
- Écrit par Yves GAUTIER
- 705 mots
Cyclosilicate d'aluminium et de béryllium, le béryl se présente sous forme de cristaux hexagonaux lisses ou striés parallèlement à l'allongement. La base des cristaux est souvent plane (perpendiculaire à l'axe de symétrie 6) ou tronquée de faces pyramidales rarement complètes. Les cristaux sont...
-
BÉRYLLIUM
- Écrit par Jean-Paul CARRON, Robert GADEAU, Jean PERROTEY
- 5 410 mots
- 5 médias
-
CHRYSOBÉRYL
- Écrit par Yves GAUTIER
- 1 061 mots
- 1 média
Oxyde de béryllium et d'aluminium, le chrysobéryl (« béryl d'or », du grec chrusos, or, et bêrullos, béryl) est une pierre fine présentant à l'état naturel des cristaux prismatiques ou tabulaires, striés, de couleur jaune verdâtre, grise, brune, vert bleuté. Il est souvent maclé...
-
COULEUR DES MINÉRAUX
- Écrit par André JULG
- 3 516 mots
- 3 médias
...(Si6O18), est rarement incolore. Des ions Cr3+, se substituant aux atomes d'aluminium, lui donnent une couleur d'un beau vert : c'est l'émeraude. Avec des ions Fe3+ en ces mêmes sites, on a l'aigue-marine, qui est bleue. Le remplacement d'atomes de béryllium par du...
Voir aussi
- ÉLÉMENTS CHIMIQUES, géochimie
- DOUBLETS, joaillerie
- CRISTAUX ARTIFICIELS
- PIERRES PRÉCIEUSES
- SYNTHÈSE DES CRISTAUX ou CRISTALLOGENÈSE, technologie
- EBELMEN JACQUES JOSEPH (1814-1852)
- CRISTALLOCHIMIE
- PLAGIOCLASES ou FELDSPATHS CALCOSODIQUES
- CRISTALLISATION
- MINÉRAUX
- PHLOGOPITE
- GISEMENT, géologie
- CYCLOSILICATES
- PEGMATITES
- ARGILES LITÉES ou SHALES
- BRÉSIL, économie