CHAOS, physique
La sensibilité aux conditions initiales
Regardons de plus près l'aspect graphique de l'itération citée plus haut. En considérant la parabole Xt+1 = AXt(1 − Xt) dans l'intervalle [0, 1], l'itération se pratique aisément à partir d'une valeur X0 en se servant de la première bissectrice. En partant d'un point très voisin X′0 = X0 + δ X et itérant de la même manière, les écarts δ = Xt+1 − Xt+1 obtenus à chaque itération sont en moyenne supérieurs aux δ Xt calculés précédemment : ils sont multipliés à chaque fois par la pente P de la parabole qui se révèle, en moyenne, être supérieure à l'unité. Un écart, une erreur initiale multipliée à chaque itération par P, croît donc, en moyenne, exponentiellement avec leur nombre. C'est dire que les deux points voisins X0 et X′0 = X0 + δ X auront rapidement des images très différentes. Autrement dit, les deux suites :
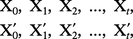
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre BERGÉ : directeur du département de recherche sur l'état condensé atomes et molécules (D.R.E.C.A.M.) au Commissariat à l'énergie atomique, Saclay
- Monique DUBOIS : physicienne au Commissariat à l'énergie atomique, chef du laboratoire de diffusion de la lumière au service de physique du solide et résonance magnétique à Saclay
Classification
Pour citer cet article
Pierre BERGÉ et Monique DUBOIS. CHAOS, physique [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
CHAOS DÉTERMINISTE THÉORIE DU
- Écrit par Bernard PIRE
- 318 mots
L'article « Sur la nature de la turbulence », publié en 1971 dans la revue Communications in Mathematical Physics, marque les débuts de la théorie du chaos déterministe. Le physicien belge David Ruelle et le mathématicien néerlandais Floris Takens y développent une vision nouvelle de la...
-
BERGÉ PIERRE (1934-1997)
- Écrit par Louis BOYER, Monique DUBOIS-GANCE, Yves POMEAU
- 831 mots
- 1 média
Pierre Bergé, chercheur et expérimentateur talentueux, fut un grand physicien dans le domaine de la matière condensée. Originaire de Pau, il fit ses études supérieures à l'École centrale de Nantes. Toute sa carrière de physicien fut effectuée au Commissariat à l'énergie atomique, centre d’études de...
-
CLIMATOLOGIE
- Écrit par Frédéric FLUTEAU, Guillaume LE HIR
- 3 656 mots
- 4 médias
Un autre aspect de la complexité du système climatique provient du caractère chaotique de l'atmosphère terrestre. Par « chaos », il faut comprendre une très grande sensibilité aux conditions initiales, qui sont, elles, imprédictibles à long terme. Il existe donc un temps au-delà duquel toute prédiction... -
CONTINGENCE
- Écrit par Bertrand SAINT-SERNIN
- 4 900 mots
...système physique supposé clos. Poincaré, Hadamard et Duhem, à la fin du xixe siècle, attirèrent l'attention sur des systèmes mécaniques où de très faibles différences dans l'état initial conduisent à des évolutions très différentes,ce qui est à l'origine de la théorie du chaos. -
FEIGENBAUM MITCHELL J. (1944-2019)
- Écrit par Bernard PIRE
- 291 mots
Mitchell J. Feigenbaum est un physicien américain né le 19 décembre 1944 à Philadelphie et mort le 30 juin 2019 à New York.
Après avoir obtenu son doctorat de physique théorique en 1970 au Massachusetts Institute of Technology, dans le domaine de la physique des particules élémentaires, et après...
- Afficher les 13 références
Voir aussi





