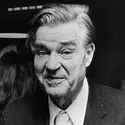BANQUES CENTRALES
Le rôle de prêteur ultime
La doctrine
L'inflation n'est qu'un des facteurs d'altération de la confiance dans la monnaie ; le risque systémique qui met en péril le système de paiements en représente un autre. Ce dernier est lié au développement des formes diverses d'instabilité financière. Elles peuvent se manifester au sein du système bancaire (par exemple, la crise des Caisses d'épargne dans les années 1980 aux États-Unis, les nombreuses crises bancaires en Europe au début des années 1990). Les banques sont vulnérables à des runs mais aussi à des chocs de liquidité ou d'insolvabilité. Au départ cantonnée à une seule banque, la difficulté s'étend à d'autres banques, par contagion et réaction en chaîne, du fait des positions de créances et dettes interbancaires. Ces externalités négatives associées aux faillites bancaires et les crises systémiques qui peuvent en résulter justifient l'intervention d'un prêteur ultime, fonction qu'une banque centrale est la mieux à même d'assumer.
L'intervention d'un prêteur ultime, la banque centrale, est soulignée chez les auteurs du xixe siècle. Selon Henry Thornton (1802), les billets de la Banque d'Angleterre (et non ceux des banques locales) sont considérés comme très liquides. Ils servent ainsi en temps normal d'instruments de règlement et sont au centre du système de paiement. Lors de crises de liquidité (comme celle de 1793, durant laquelle se produisirent de nombreuses faillites bancaires, une conversion de dépôts en billets et une thésaurisation de billets), la recherche d'actifs liquides pouvant servir de moyens de règlement aboutit à raréfier ces derniers. Le système de paiements menace alors de rompre. L'intervention conjoncturelle et temporaire de la Banque d'Angleterre (qui n'est pas publique mais qui devrait avoir en charge l'intérêt général) peut alors être nécessaire pour offrir de la monnaie de base, en s'affranchissant de la contrainte imposant de respecter un coefficient fixe de réserves métalliques. Son intervention vise à rétablir la régularité des paiements, et donc la confiance, et à éviter les faillites de banques solvables et les conséquences qui en résultent sur le secteur réel. Elle peut s'adresser à l'ensemble des banques ou soutenir celles qui représentent un maillon faible du système.
Ce rôle de prêteur ultime, qui concerne les périodes courtes de crises, se distingue de l'action de politique monétaire mais doit cependant lui être articulé. Walter Bagehot, en 1873, a développé les principes qui doivent guider l'intervention du prêteur ultime : la banque centrale doit prêter sans limites, à un taux d'intérêt pénalisant, à l'ensemble du marché, aux seules banques illiquides mais solvables, c'est-à-dire en contrepartie de garanties ou d'actifs de bonne qualité, évalués à leur valeur économique normale avant la crise.
La pratique
Plus près de nous, l'action du prêteur ultime s'est modifiée pour tenir compte de l'évolution des structures financières. Le mouvement de concentration bancaire, l'interpénétration des positions et la difficulté de distinguer entre situations d'illiquidité et situations d'insolvabilité ont amené les responsables monétaires à prêter à toute institution de grande taille dont la faillite risque d'entraîner avec elle celle du système : c'est le principe du too big to fail.
Le prêteur ultime est menacé par le phénomène de l'aléa moral, inhérent à tout mécanisme d'assurance, puisqu'il s'agit ici d'une assurance contre le risque d'illiquidité. Il peut, en effet, par sa propre action, encourager l'imprudence des banques assurées qui savent que leur action n'est pas observable. Il doit donc ne pas agir de façon automatique et créer une incertitude[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Sylvie DIATKINE : professeur d'Université en sciences économiques, université de Paris-XII
Classification
Pour citer cet article
Sylvie DIATKINE. BANQUES CENTRALES [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Média
Autres références
-
AGIOS
- Écrit par André BOYER
- 371 mots
En matière bancaire, ensemble des retenues opérées par le banquier, en contrepartie de l'escompte d'un effet de commerce. Les agios et l'escompte ne se confondent pas : l'escompte est le prêt accordé par une banque lorsqu'elle acquiert un effet de commerce avant son échéance ; les agios constituent...
-
ANTICIPATIONS, économie
- Écrit par Christian de BOISSIEU
- 6 072 mots
- 4 médias
...déterminant dans la formation à court terme des taux de change, sont conditionnés par les anticipations d'évolution des taux d'intérêt et des taux de change. La hausse du taux d'escompte de la banque centrale est d'ailleurs un instrument de défense de la monnaie ambigu : elle peut être interprétée par les opérateurs... -
ARGENTINE
- Écrit par Jacques BRASSEUL, Universalis, Romain GAIGNARD, Roland LABARRE, Luis MIOTTI, Carlos QUENAN, Jérémy RUBENSTEIN, Sébastien VELUT
- 37 033 mots
- 18 médias
...proportion, par des titres de la dette publique en dollars – doivent couvrir, au moins à 100 %, la base monétaire, c'est-à-dire les engagements monétaires de la Banque centrale (billets et pièces, dépôts à vue des institutions financières auprès de la Banque centrale et comptes spéciaux). La Banque centrale, devenue... -
BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE (BCE)
- Écrit par Jézabel COUPPEY
- 1 142 mots
La Banque centrale européenne (B.C.E.) est entrée en fonction le 1er juillet 1998, quelques mois avant l'ultime phase de l'union monétaire (la troisième phase de l'Union économique et monétaire selon le traité sur l'Union européenne signé à Maastricht en 1992), marquée par le basculement à l'...
- Afficher les 63 références
Voir aussi
- NÉO-CLASSIQUE THÉORIE ÉCONOMIQUE
- MARCHÉS DE CAPITAUX
- PRIX INDICE DES
- MONNAIE SCRIPTURALE
- BANQUE HISTOIRE DE LA
- INSTABILITÉ FINANCIÈRE
- ÉCONOMIE DE LA BANQUE
- CRISES BANCAIRES
- PRÊTEUR EN DERNIER RESSORT
- TAUX DIRECTEURS
- CURRENCY BOARD ou CAISSE D'ÉMISSION
- ALÉA MORAL
- REFINANCEMENT
- TRIANGLE D'INCOMPATIBILTÉ, économie
- ROYAUME-UNI, histoire, de 1801 à 1914
- POLITIQUE MONÉTAIRE
- MARCHÉ MONÉTAIRE
- KEYNÉSIEN SYSTÈME ÉCONOMIQUE
- INSTITUTIONS FINANCIÈRES INTERNATIONALES
- BANQUE COMMERCIALE
- ÉMISSION MONÉTAIRE
- BANQUE DE FRANCE
- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1801 à 1914
- MONÉTARISME
- HISTOIRE ÉCONOMIQUE
- RÉGULATION MONÉTAIRE & FINANCIÈRE
- BANQUE D'AMSTERDAM (Amsterdamsche Wisselbank)