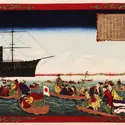KYŌTO
Le déclin de Heian-kyō
Même si l'on tient compte de la richesse de la société aristocratique, le plan de la capitale avait été conçu de façon trop ambitieuse pour la population réelle et beaucoup de quartiers ne furent jamais construits. En outre, la capitale de droite était implantée sur un sol marécageux, et, très tôt, les habitations qui s'y trouvaient furent délaissées au profit des terres de la moitié est de la ville. Du fait de ce déplacement progressif des populations, la cité interdite n'occupa plus le centre physique de l'organisation urbaine.
Jusqu'au début de l'époque de Kamakura (1185-1333), l'évolution urbaine de la capitale est restée intimement liée au lieu du pouvoir politique. Au xiie siècle, les empereurs retirés se sont installés dans le quartier de Shirakawa, qui se développe alors à l'est de la Kamo, et à l'époque de la splendeur des Taira de vastes palais sont bâtis à Rokuhara, au sud de Shirakawa.
Au début du xiiie siècle, Kyōto demeurait une ville dominée culturellement – et même politiquement – par l'aristocratie civile et les empereurs retirés ; cela, malgré le pouvoir qu'exerçait le gouvernement militaire (bakufu) installé depuis peu à Kamakura et celui de son représentant à la capitale, le gouverneur de Kyōto. Mais, à la suite des troubles de l'ère Jōkyū et de l'échec de l'empereur retiré Gotoba (1180-1239) dans son effort pour restaurer la puissance impériale, le bakufu de Kamakura a établi une complète hégémonie sur les affaires du pays. C'est à cette époque que, profitant de l'incendie de 1227 qui avait réduit en cendres la cité interdite, il a décidé de ne plus faire reconstruire le palais, jadis centre spirituel de la ville. La disparition de ce centre symbolique a définitivement marqué l'entrée de la capitale dans une ère nouvelle ; et c'est à cette époque que le toponyme Kyōto (« la Capitale ») a remplacé celui de Heian-kyō.
La chute de l'ancien régime, l'émergence d'une société marquée par un émiettement des pouvoirs et la militarisation des couches dirigeantes ont eu pour conséquence le passage d'un type urbain à un autre. Ordre géométrique, formes pures des tracés urbains, expression de la centralité du palais impérial disparurent simultanément quand le pouvoir séculier prit le pas sur le pouvoir spirituel. La perte du noyau symbolique – l'antique palais – libéra en quelque sorte chacune des parties (quartiers, rues, marchés, habitations, etc.), qui se restructura selon les nouvelles donnes de la société médiévale. Les destructions et reconstructions causées par les guerres ou les catastrophes naturelles, si fréquentes au Moyen Âge, dynamisèrent l'évolution des formes urbaines et architecturales. Du xiiie au xve siècle, une croissance organique de la ville s'est accomplie, favorisée par une juxtaposition d'hommes de conditions, de classes et de professions variées.
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Nicolas FIÉVÉ : docteur ès lettres en études de l'Extrême-Orient, architecte D.P.L.G., chargé de recherche au C.N.R.S.
- Raphaël LANGUILLON-AUSSEL : docteur agrégé de géographie
Classification
Pour citer cet article
Nicolas FIÉVÉ et Raphaël LANGUILLON-AUSSEL. KYŌTO [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
JAPON (Le territoire et les hommes) - Histoire
- Écrit par Paul AKAMATSU, Vadime ELISSEEFF, Universalis, Valérie NIQUET, Céline PAJON
- 44 405 mots
- 52 médias
...alors une grande popularité en Chine, le Tiantai (en japonais Tendai) et le Zhenyan (en japonais Shingon), et déplaça la capitale à Heiankyō, l'actuelle Kyōto, inaugurant ainsi en 794 une nouvelle période de l'histoire japonaise. On désigne sous le nom d'époque Heian (Heian jidai), d'une... -
JAPON (Arts et culture) - Les arts
- Écrit par François BERTHIER, François CHASLIN, Universalis, Nicolas FIÉVÉ, Anne GOSSOT, Chantal KOZYREFF, Hervé LE GOFF, Françoise LEVAILLANT, Daisy LION-GOLDSCHMIDT, Shiori NAKAMA, Madeleine PAUL-DAVID
- 56 170 mots
- 35 médias
À Heian-kyō, le carroyage urbain dessine des îlots carrés de 120 mètres de côté et une propriété occupe, selon le rang et la fortune, un quart, une moitié ou la totalité d'un îlot ; parfois deux, voire quatre îlots pour les plus fortunés. Chaque propriété est ceinte d'un mur en pisé, percé d'une porte... -
JARDINS "SECS", Kyōto (Japon)
- Écrit par Alain THOTE
- 185 mots
- 1 média
Courant religieux venu de Chine à partir du milieu du xiiie siècle, le bouddhisme chan (zen) a inspiré le développement de plusieurs formes d'art au Japon, comme la cérémonie du thé (chanoyu), l'arrangement floral (ikebana) ou la peinture monochrome. Parmi elles, mais de création...
-
KANSAI ou KINKI
- Écrit par Raphaël LANGUILLON-AUSSEL
- 1 022 mots
- 1 média
Grande rivale culturelle du Kantō, le Kansai, aussi appelé parfois Kinki ou Kinai, est une région située au centre de l'île japonaise de Honshū. D'une superficie de 33 108 kilomètres carrés, elle est composée de sept départements (Kyōto, Osaka, Hyōgo, Nara, Shiga, Wakayama et...
Voir aussi