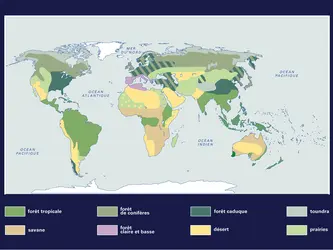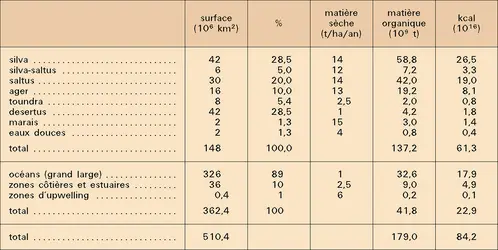BIOSPHÈRE
L'idée de biosphère, ensemble des êtres vivants qui peuplent notre planète, remonte à J.-B. Lamarck. C'est ensuite le géologue autrichien Suess qui, en 1875, a mis en parallèle le terme de biosphère avec ceux d'hydrosphère, d'atmosphère et de lithosphère. Il étendait en fait le concept à tout ce qui constituait ou avait constitué le monde vivant, en y incluant donc aussi, par exemple, les gisements de charbon et les roches calcaires des récifs coralliensfossiles. Une acception plus dynamique du terme a été adoptée plus tard par le géochimiste russe Vladimir Ivanovitch Vernadsky (1929) : il considère dans la biosphère, outre les êtres vivants eux-mêmes, les éléments du milieu au sein duquel se déroulent les échanges d'énergie et de matière qui permettent et caractérisent leur fonctionnement. Vue sous cet angle fonctionnel qui prend en considération les interactions des êtres vivants avec les composantes physico-chimiques du milieu, la biosphère est un gigantesque système dynamique formé par l'ensemble des écosystèmes (et non pas seulement des biocénoses) du globe. Cette définition est souvent considérée comme redondante avec celle d'écosphère même s'il est vrai que les deux notions se recouvrent sans se confondre : la biosphère privilégie le monde vivant tandis que l'écosphère englobe aussi les interactions de ce dernier avec l'environnement géologique et climatique. La notion d'écosphère a été créée par L. C. Cole en 1958 pour désigner la partie de la planète qui renferme l'ensemble des êtres vivants et leur environnement immédiat, qui n'héberge pas la vie mais dont les propriétés physico-chimiques créent les conditions favorables à la vie à la surface de la Terre plus étendue. La biosphère est constituée de trois compartiments : la basse atmosphère, l'hydrosphère – essentiellement constituée par l'océan mondial – et les couches les plus superficielles de la lithosphère (sols et sédiments superficiels marins). S'étendant du fond des grandes fosses océaniques (— 11 000 mètres) jusqu'à 6 000 mètres d'altitude, elle présente une succession de milieux très différents, les écosystèmes. La biosphère ne peut être qu'hétérogène puisque les conditions des milieux où existe la vie sont différentes selon les espaces climatiques et géographiques. L'écosphère, quant à elle, inclut des enveloppes plus externes ou plus internes que celle-ci, en particulier, la couche d'ozone stratosphérique et les premiers kilomètres de la lithosphère.
Composition et structure de la biosphère
Composition chimique
Les éléments chimiques qui sont présents dans la biosphère, c'est-à-dire qui constituent la matière des êtres vivants, sont nombreux, mais leur importance quantitative est très variable. Le carbone est l'élément de base de la matière organique, qui renferme aussi en quantités non négligeables de l'azote, du phosphore et, dans une moindre mesure, du soufre et du fer. L'abondance de l'oxygène et de l'hydrogène est liée à la forte proportion d'eau qui constitue les êtres vivants. Divers sels minéraux comme des chlorures, des bicarbonates et des phosphates de sodium, de potassium, de calcium et de magnésium, tous solubles dans l'eau, jouent un rôle important dans la physiologie des organismes. D'autres éléments sont présents, mais en quantités le plus souvent très faibles, comme le bore, l'aluminium, le cuivre, le zinc, le silicium, le gallium, le molybdène, le manganèse, le cobalt et l'iode.
Plus encore que les proportions relatives différentes des divers atomes, c'est la complexité de ses molécules qui fait l'originalité chimique majeure de la matière vivante ; c'est pourquoi leur étude constitue un domaine à part de la chimie : la chimie organique.[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Paul DUVIGNEAUD : professeur à l'Université libre de Bruxelles
- Maxime LAMOTTE : professeur honoraire à l'université de Paris-VI-Pierre-et-Marie-Curie (faculté des sciences), ancien directeur du laboratoire de zoologie de l'École normale supérieure
- François RAMADE : professeur émérite d'écologie à la faculté des sciences d'Orsay, université de Paris-Sud-Orsay
Classification
Pour citer cet article
Paul DUVIGNEAUD, Maxime LAMOTTE et François RAMADE. BIOSPHÈRE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
BIODIVERSITÉ
- Écrit par Isabelle CHUINE, Sandra LAVOREL
- 5 883 mots
- 10 médias
Le terme biodiversité est venu supplanter en quelque sorte celui de biosphère introduit pour la première fois en 1885 par le géologue autrichien Eduard Suess (1831-1914). La biosphère représente l’ensemble des organismes vivants ainsi que les milieux dans lesquels ils vivent. Elle comprend donc à la... -
CLIMAX
- Écrit par Yolande LUBIN
- 661 mots
Emprunté à la phytosociologie, le terme « climax » désigne l'ensemble sol-végétation caractérisant un milieu donné et parvenu, en l'absence de perturbations extérieures, à un état terminal d'évolution. Le climax du sol ou pédoclimax est constitué par le profil pédologique en équilibre, par l'intermédiaire...
-
CYCLES BIOGÉOCHIMIQUES
- Écrit par Jean-Claude DUPLESSY
- 7 878 mots
- 6 médias
Si l'hydrogène (H) est l'élément le plus abondant de la biosphère, il n'apparaît qu'exceptionnellement à l'état libre, au sein de quelques fermentations bactériennes, bien qu'il soit le vecteur essentiel de la bioénergétique : photosynthèse, respiration, fermentation.... -
ÉCOLOGIE
- Écrit par Patrick BLANDIN, Denis COUVET, Maxime LAMOTTE, Cesare F. SACCHI
- 20 635 mots
- 15 médias
Le terme écologie (du grec oikos, demeure, et logos, science) a été proposé par Ernst Haeckel en 1866 pour désigner la science qui étudie les rapports entre les organismes et le milieu où ils vivent. Cette définition reste encore valable, mais elle demande à être approfondie et précisée, car elle...
- Afficher les 15 références
Voir aussi