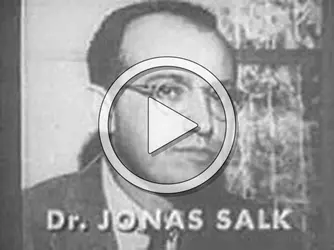POLIOMYÉLITE
La poliomyélite, ou paralysie infantile, est l'une des premières maladies à virus de l'homme qui ait, après la rage (1881) et la fièvre jaune (1901), fait l'objet de recherches expérimentales et épidémiologiques systématiques (1909). Le grand neurologiste français Alfred Vulpian en avait donné en 1871 une définition remarquable qui a gardé toute sa valeur : « Cette paralysie atrophique est vraisemblablement une maladie infectieuse aiguë, laquelle dépend d'une infection généralisée du corps, qui se localise de préférence dans une région circonscrite de la moelle. »
Un paradoxe intrigua longtemps chercheurs et cliniciens. Plus se développaient dans le monde occidental l'hygiène, le niveau de vie et la prophylaxie des maladies infectieuses, plus les cas de poliomyélite augmentaient en fréquence et en gravité. On enregistra, au cours de la première moitié du xxe siècle, une véritable marée montante de cette infection de plus en plus redoutable. La pression de l'opinion publique, les progrès de l'étude des virus et de leur culture ont suscité la mise au point de vaccins contre la poliomyélite, et abouti au plus grand succès jamais enregistré par les seules méthodes vaccinales : le recul de la maladie allant jusqu'à sa disparition complète en certains pays, alors que la thérapeutique était et reste encore complètement désarmée devant elle.
La maladie
La poliomyélite est une maladie infectieuse aiguë de l'homme, dans laquelle la destruction des cellules motrices du système nerveux central a pour conséquence soit des paralysies des membres, soit une atteinte respiratoire, ces deux types de lésions pouvant se combiner et entraîner la mort par asphyxie due à l'atteinte des centres nerveux bulbaires qui commandent la ventilation pulmonaire. Après une phase aiguë, fébrile, les paralysies peuvent régresser totalement ; le plus souvent, cependant, persistent des séquelles motrices (paralysies) permanentes plus ou moins étendues, localisées en général dans les membres inférieurs. Lorsque la maladie s'est attaquée à des enfants, elle perturbe gravement à ce niveau leur croissance, laissant ainsi de lourds handicaps pour le reste de la vie.
Sous sa forme la plus classique dite paralysie infantile, la poliomyélite paraît avoir existé de tout temps : une stèle égyptienne de la XIXe dynastie thébaine en apporte un témoignage graphique. Autrefois confondue avec les paralysies obstétricales ou traumatiques de l'enfance, elle a été individualisée cliniquement en 1840 par le médecin wurtembergeois J. von Heine. Le caractère infectieux de la poliomyélite, affirmé dès 1870 par Vulpian sur la base des lésions anatomo-pathologiques, a été démontré par l'épidémiologie : 13 cas à Sainte-Foy-l'Argentière décrits en 1886 par M. Cordier ; 44 en 1887 à Stockholm observés par K. O. Medin, d'où le nom de maladie de Heine-Medin parfois donné à la poliomyélite.
La maladie se présente tantôt sous forme de cas sporadiques sans relation apparente, tantôt sous forme de cas groupés en foyers où l'infection revêt, pendant un certain temps, une allure endémique. Enfin, on assiste périodiquement, chez les populations que ne protège pas l'immunisation spontanée ou vaccinale, à des épidémies massives frappant un grand nombre de personnes en un court espace de temps. Avant la pratique de la vaccination, les pays scandinaves étaient les plus atteints en Europe. Aux États-Unis, l'infection fut reconnue en 1894 ; la maladie s'y est manifestée comme ailleurs avec une fréquence croissante, ponctuée, tous les quatre ou cinq ans, par de grandes épidémies. En 1916, il y eut aux États-Unis 29 000 cas causant 6 000 décès ; en 1952, 57 740 cas ; en 1955, la vaccination cassait la courbe ascendante.
La poliomyélite affecte plus particulièrement[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre LÉPINE : professeur honoraire de l'Institut Pasteur, membre de l'Académie des sciences et de l'Académie nationale de médecine
Classification
Pour citer cet article
Pierre LÉPINE. POLIOMYÉLITE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
KOPROWSKI HILARY (1916-2013)
- Écrit par Melinda C. SHEPHERD
- 491 mots
Le virologue polonais Hilary Koprowski mit au point un vaccin vivant atténué efficace contre la poliomyélite, administré par voie orale. Il effectua le premier essai clinique en 1950, soit deux ans avant que l’équipe de Jonas Salk teste son vaccin inactivé injectable, neuf ans avant qu’Albert...
-
LANDSTEINER KARL (1868-1943)
- Écrit par Paul SPEISER
- 912 mots
- 2 médias
En injectant à un singe de la moelle épinière homogénéisée d'un enfant mort de poliomyélite, Landsteiner réussit à reproduire les altérations caractéristiques de cette maladie (lésions de la moelle, paralysie). En collaboration avec C. Levaditi (Institut Pasteur, Paris), il décrit une méthode sérologique... -
LÉPINE PIERRE (1901-1989)
- Écrit par Léon LE MINOR
- 1 367 mots
Né à Lyon en 1901, Pierre Lépine s'engagea lui aussi dans la carrière médicale. Il fut externe, puis interne des hôpitaux de Lyon et, très tôt, s'intéressa au travail de laboratoire : au cours de ses études médicales, il fut moniteur de physiologie à la faculté des sciences, puis assistant de parasitologie...
-
LEVADITI CONSTANTIN (1874-1953)
- Écrit par Jean LEVADITI
- 505 mots
Né à Galati (Roumanie), Constantin Levaditi, médecin français, est d'abord, en 1896, interne des hôpitaux à Bucarest et se consacre à des recherches expérimentales. Après avoir été préparateur du professeur Babes à Bucarest, il est nommé à Paris préparateur du professeur Charrin au Collège de France....
- Afficher les 12 références
Voir aussi