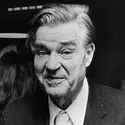MACROÉCONOMIE Théorie macroéconomique
Trois champs majeurs de la théorie macroéconomique
Il convient maintenant d'en venir au contenu des théories macroéconomiques. Il ne saurait être question d'un traitement exhaustif du champ couvert par ces théories, qui est beaucoup trop vaste et complexe. Une sélection s'impose, qui puisse prétendre donner une idée juste d'une partie du champ en cause et servir d'introduction à l'appréhension des autres champs.
Trois thèmes ont constitué au xxe siècle des objets de préoccupation autour desquels se sont constitués des chapitres importants de la théorie macroéconomique : le sous-emploi, les fluctuations conjoncturelles et les facteurs de la croissance.
Le multiplicateur keynésien
Dans les années 1930, face à la Grande Crise et au chômage, les économistes furent divisés quant à l'opportunité de politiques budgétaires et monétaires actives réclamées par nombre de commentateurs. Pour soutenir l'activité fallait-il engager des travaux publics, accepter des réductions d'impôts et provoquer la baisse des taux d'intérêt par d'importantes émissions de monnaie ? Ayant pris l'habitude de déplorer l'inflation et les désordres du système économique induits par le laxisme des autorités politiques, beaucoup d'économistes s'y opposaient. Mais une substantielle minorité d'entre eux y devenait favorable. Dans son ouvrage, La Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, publié en 1936, John Maynard Keynes, professeur à Cambridge mais familier des prises de position publiques, apporta son soutien à la thèse minoritaire.
Bien que l'ouvrage ait paru ardu et ait introduit de nombreuses nuances par rapport aux hypothèses les plus critiques pour la validité de ses recommandations, il fut suivi de la publication de modèles simplificateurs vite intégrés dans les enseignements d'économie. Le message principal du livre consistait à faire apparaître que l'existence fréquente d'un sous-emploi invalidait deux lois de l'économie classique : la loi de Say énonçant que l'offre, de travail par exemple, crée sa propre demande et la théorie quantitative de la monnaie, selon laquelle le niveau des prix s'adapte aux variations de la quantité globale de monnaie. Les modèles traduisant la théorie keynésienne expriment au contraire l'idée que, en dehors du plein-emploi, le niveau des prix est insensible aux variations de la quantité de monnaie, tandis que la demande des biens et services est inférieure à l'offre potentielle. Susciter une hausse de cette demande se traduit alors par une augmentation de la production et de l'emploi. Il y a même un effet multiplicateur : du fait des interdépendances entre production, revenu, consommation et demande globale, la production croîtra plus que la stimulation apportée initialement à la demande.
Le modèle du multiplicateur keynésien a dès lors souvent été exprimé à l'aide des trois équations suivantes :
Q = C + I + G,
C = a (R/p) + b,
R = pQ — T,
où Q, C, I et G sont respectivement les volumes de la production, de la consommation, de l'investissement privé et de la demande publique, où p est le niveau des prix, R la valeur du revenu privé, T celle des impôts, et où a et b sont des nombres caractérisant la loi de formation de la consommation, a étant positif et inférieur à 1. Les trois grandeurs Q, C et R sont considérées comme conjointement déterminées par les grandeurs p, I, G et T considérées comme exogènes : p résultant de prix antérieurement établis, I de décisions privées autonomes, G et T de décisions publiques, ces deux dernières grandeurs étant justement considérées comme instruments de la politique budgétaire. Les trois équations impliquent :
Q = k[I + G — a(T/p) + b],
où k est le multiplicateur égal à 1/(1 — a), donc plus grand que[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Edmond MALINVAUD : professeur honoraire au Collège de France
Classification
Pour citer cet article
Edmond MALINVAUD. MACROÉCONOMIE - Théorie macroéconomique [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Autres références
-
AGRÉGAT ÉCONOMIQUE
- Écrit par Marc PÉNIN
- 1 488 mots
Au sens premier, un agrégat est un assemblage de parties qui forment un tout. Dans le vocabulaire économique moderne, le mot désigne une grandeur caractéristique de l'économie nationale et, plus généralement, une grandeur globale synthétique représentative d'un ensemble de grandeurs particulières. Le...
-
ANTICIPATIONS, économie
- Écrit par Christian de BOISSIEU
- 6 072 mots
- 4 médias
Puisque les variables macroéconomiques résultent de la conjugaison des actions individuelles, elles sont également conditionnées par les prévisions. Donnons quelques exemples : -
CAPITAL
- Écrit par Ozgur GUN
- 1 387 mots
Cette façon de concevoir la société est, en partie, sous-jacente dans les représentations actuelles de ce que les économistes appellent la macroéconomie, lorsqu'ils considèrent que le produit national est obtenu à partir du capital et du travail. Mais à la vision d'une lutte pour le partage du produit... -
CHÔMAGE - Politiques de l'emploi
- Écrit par Christine ERHEL
- 7 302 mots
- 2 médias
Les évaluations macroéconomiques mesurent l'impact des politiques de l'emploi sur l'emploi, le chômage, les salaires, ou encore sur les flux sur le marché du travail, au niveau global. Elles utilisent des données agrégées, et éventuellement des modèles macroéconométriques existants. - Afficher les 27 références
Voir aussi
- PSYCHOLOGIE ÉCONOMIQUE
- INDICE, économie
- MODÈLES ET MODÉLISATION, économie
- PRODUCTION FONCTION DE
- KEYNÉSIANISME
- MITCHELL WESLEY C. (1874-1948)
- MARCHÉ DU TRAVAIL
- POLITIQUE MONÉTAIRE
- POLITIQUE ÉCONOMIQUE
- MULTIPLICATEUR, économie
- CROISSANCE ÉCONOMIQUE
- PENSÉE ÉCONOMIQUE HISTOIRE DE LA
- POLITIQUE BUDGÉTAIRE