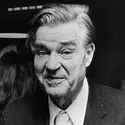MACROÉCONOMIE Théorie macroéconomique
État de la recherche contemporaine en macroéconomie
On a cherché dans ce qui précède à faire apparaître les orientations prises au milieu du xxe siècle, à l'époque où s'est constituée la théorie macroéconomique. Il reste à considérer quelques exemples typiques des évolutions qu'a connues depuis lors cette branche vivante de la discipline économique.
Investigations macro et microéconométriques sur l'épargne des ménages
Le recours à l'économétrie a été massif, en symbiose avec l'affinement des conceptualisations théoriques. Il est notable aussi qu'une partie des recherches a porté sur les fondements microéconomiques et sur les agrégations sous-jacentes aux lois de comportement figurant dans les modèles macroéconomiques. À titre d'exemple, nous allons considérer la fonction de consommation inscrite dans le modèle du multiplicateur. Dans la théorie générale, Keynes s'était expliqué à son sujet, lui consacrant le chapitre 10 intitulé « La Propension marginale à consommer et le multiplicateur ». Il avait alors fait appel à la psychologie pour justifier l'hypothèse selon laquelle normalement le paramètre a dans le modèle du multiplicateur keynésien présenté ci-dessus devait être positif et inférieur à 1 (lorsque le revenu augmente, la consommation augmente, mais d'un montant moindre). Qu'en est-il aujourd'hui, alors qu'ont été effectuées de nombreuses études empiriques sur ce sujet ? Au risque de caricaturer les choses, nous pouvons distinguer quatre étapes.
Dans l'immédiat après-guerre, une confirmation de l'hypothèse keynésienne fut apportée par des évaluations rétrospectives des grands agrégats de la comptabilité nationale. Des séries annuelles sur l'entre-deux-guerres commençaient à être publiées et s'ajustaient approximativement sur la relation linéaire posée dans le modèle keynésien. Peu à peu, on reconnut cependant le besoin de faire intervenir un retard de la consommation par rapport au revenu, tel qu'il apparaît sous la forme suivante souvent retenue : Ct = aRt/pt + bCt—1 + c.
Une certaine effervescence s'ensuivit dans les années 1950 et 1960. Le retard fut expliqué par Milton Friedman grâce à son hypothèse du revenu permanent, lequel était censé mesurer en quelque sorte le niveau moyen du flux des revenus que les ménages s'attendaient à percevoir, un flux qui était lui-même calqué avec retard sur le revenu perçu. Une hypothèse alternative consistait à faire intervenir dans la fonction de consommation la richesse des ménages à côté de leur revenu. Simultanément Franco Modigliani avait lancé son hypothèse du cycle de vie selon laquelle chaque ménage a un plan de consommation qu'il adapte peu à peu en fonction de ce qu'il estime devoir être les flux de ses revenus et de ses besoins durant le reste de sa vie. La fonction de consommation à faire intervenir dans la théorie macroéconomique doit résulter de l'agrégation des demandes de tous les ménages appartenant aux diverses générations. Pour étayer l'hypothèse qu'il maintint tout au long de sa vie, Modigliani fit état de sources empiriques diverses, notamment de données microéconomiques sur les budgets d'échantillons représentatifs de ménages individuellement interrogés.
Durant une troisième étape, particulièrement active au cours des années 1980, l'attention se porta sur les caractéristiques du processus stochastique bidimensionnel constitué conjointement par l'évolution du revenu disponible des ménages et par celle de leur consommation (cela le plus souvent sur des séries de données trimestrielles). L'intention était d'abord empirique : plutôt que de préjuger l'existence et la forme d'une fonction de consommation, ainsi que cela avait été fait antérieurement, il s'agissait de voir si les propriétés statistiques dynamiques[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Edmond MALINVAUD : professeur honoraire au Collège de France
Classification
Pour citer cet article
Edmond MALINVAUD. MACROÉCONOMIE - Théorie macroéconomique [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Autres références
-
AGRÉGAT ÉCONOMIQUE
- Écrit par Marc PÉNIN
- 1 488 mots
Au sens premier, un agrégat est un assemblage de parties qui forment un tout. Dans le vocabulaire économique moderne, le mot désigne une grandeur caractéristique de l'économie nationale et, plus généralement, une grandeur globale synthétique représentative d'un ensemble de grandeurs particulières. Le...
-
ANTICIPATIONS, économie
- Écrit par Christian de BOISSIEU
- 6 072 mots
- 4 médias
Puisque les variables macroéconomiques résultent de la conjugaison des actions individuelles, elles sont également conditionnées par les prévisions. Donnons quelques exemples : -
CAPITAL
- Écrit par Ozgur GUN
- 1 387 mots
Cette façon de concevoir la société est, en partie, sous-jacente dans les représentations actuelles de ce que les économistes appellent la macroéconomie, lorsqu'ils considèrent que le produit national est obtenu à partir du capital et du travail. Mais à la vision d'une lutte pour le partage du produit... -
CHÔMAGE - Politiques de l'emploi
- Écrit par Christine ERHEL
- 7 302 mots
- 2 médias
Les évaluations macroéconomiques mesurent l'impact des politiques de l'emploi sur l'emploi, le chômage, les salaires, ou encore sur les flux sur le marché du travail, au niveau global. Elles utilisent des données agrégées, et éventuellement des modèles macroéconométriques existants. - Afficher les 27 références
Voir aussi
- PSYCHOLOGIE ÉCONOMIQUE
- INDICE, économie
- MODÈLES ET MODÉLISATION, économie
- PRODUCTION FONCTION DE
- KEYNÉSIANISME
- MITCHELL WESLEY C. (1874-1948)
- MARCHÉ DU TRAVAIL
- POLITIQUE MONÉTAIRE
- POLITIQUE ÉCONOMIQUE
- MULTIPLICATEUR, économie
- CROISSANCE ÉCONOMIQUE
- PENSÉE ÉCONOMIQUE HISTOIRE DE LA
- POLITIQUE BUDGÉTAIRE