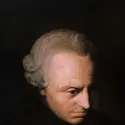KANT EMMANUEL, en bref
Véritable « révolution dans l'art de penser », la critique kantienne se veut en rupture avec tout ce qui l'a précédée. Si Kant loue Hume de l'avoir « réveillé de son sommeil dogmatique » c'est pour reposer à nouveaux frais les questions fondamentales de la philosophie : « Que puis-je savoir ? Que dois-je faire ? Que m'est-il permis d'espérer ? Qu'est-ce que l'homme ? » Les réponses données par les empiristes et par les idéalistes à ces questions sont insuffisantes, voire contradictoires. L'empirisme, par excès de réalisme, faute d'avoir distingué l'a priori de l'a posteriori, ne peut déboucher que sur le scepticisme ; l'idéalisme, faute de s'être interrogé sur les limites de nos pouvoirs de connaître, aboutit à des pensées qui dépassent de loin nos possibilités. Qu'ils soient post-, néo- ou anti-kantiens, tous les philosophes, depuis lors, se verront dans la quasi-obligation de se situer par rapport aux exigences de la critique – examen du « pouvoir de la raison en général considéré par rapport à toutes les connaissances auxquelles elle peut s'élever indépendamment de l'expérience » – qui aura ainsi ouvert une nouvelle époque dans la pensée.
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Francis WYBRANDS : professeur de philosophie
Classification
Pour citer cet article
Francis WYBRANDS. KANT EMMANUEL, en bref [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Média
Autres références
-
CRITIQUE DE LA FACULTÉ DE JUGER, Emmanuel Kant - Fiche de lecture
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 1 040 mots
La Critique de la faculté de juger (Kritik der Urteilskraft, 1790) est la troisième et dernière des Critiques d'Emmanuel Kant (1724-1804). Elle vient après la Critique de la raison pure (1781) et la Critique de la raison pratique (1786). Il ne s'agit pas tant d'ajouter au domaine des sciences...
-
CRITIQUE DE LA RAISON PURE, Emmanuel Kant - Fiche de lecture
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 961 mots
- 1 média
Dans la Préface à la première édition de la Critique de la raison pure (1781), Emmanuel Kant (1724-1804) établit un parallèle célèbre entre les progrès des sciences exactes et la confusion qui règne dans la « métaphysique », pourtant la plus ancienne et longtemps la plus prestigieuse des...
-
FONDEMENTS DE LA MÉTAPHYSIQUE DES MŒURS, Emmanuel Kant - Fiche de lecture
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 861 mots
En 1781, la Critique de la raison pure d'Emmanuel Kant (1724-1804) marquait nettement la différence de statut entre les sciences exactes et les sciences humaines. Elle soulignait aussi que toute science se décompose en connaissance a priori (ce que Kant appelle, en un sens technique, « métaphysique...
-
QU'EST-CE QUE LES LUMIÈRES ? Emmanuel Kant - Fiche de lecture
- Écrit par Philippe GRANAROLO
- 1 136 mots
Publié en 1784 dans la BerlinischeMonatsschrift, soit trois ans après la Critique de la raison pure (1781) et quatre ans avant la Critique de la raison pratique (1788), Qu’est-ce que les Lumières ? peut être considéré comme le bouquet du feu d’artifice de cette période qualifiée d’ « ...
-
ABSTRAIT ART
- Écrit par Denys RIOUT
- 6 716 mots
- 2 médias
Lorsque Kant oppose la « beauté adhérente », déterminée par la perfection de ce que doit être l'objet dans lequel elle se manifeste, à la « beauté libre », sans concept, il prend pour exemple de cette dernière non seulement les fleurs, le colibri, l'oiseau de paradis, les crustacés... -
ÉDUCATION / INSTRUCTION, notion d'
- Écrit par Daniel HAMELINE
- 1 299 mots
On pourrait penser, dans un premier temps, que les rapports entre « éduquer » et « instruire » sont simples à établir. Si l'on se réfère à la définition qu' Emmanuel Kant donne de l'éducation, à la fin du xviiie siècle, l'instruction apparaît, à côté « des soins, de...
-
AFFECTIVITÉ
- Écrit par Marc RICHIR
- 12 228 mots
La profonde nouveauté de Kant dans l'histoire de la philosophie, le « renversement » ou la « révolution copernicienne », consiste en sa conception architectonique de la pensée, c'est-à-dire en ce que les termes (concepts) et les choses (Sachen) de la pensée dépendent, dans leur... -
ANALYTIQUE PROPOSITION
- Écrit par Françoise ARMENGAUD
- 459 mots
Le mot « analytique » a au moins trois sens.
1. Au sens large, une proposition est dite analytique si elle est vraie en vertu de la signification des termes qu'elle contient. La simple considération des significations suffit à donner l'assurance de sa vérité. À ce sens se rattachent le...
- Afficher les 160 références
Voir aussi