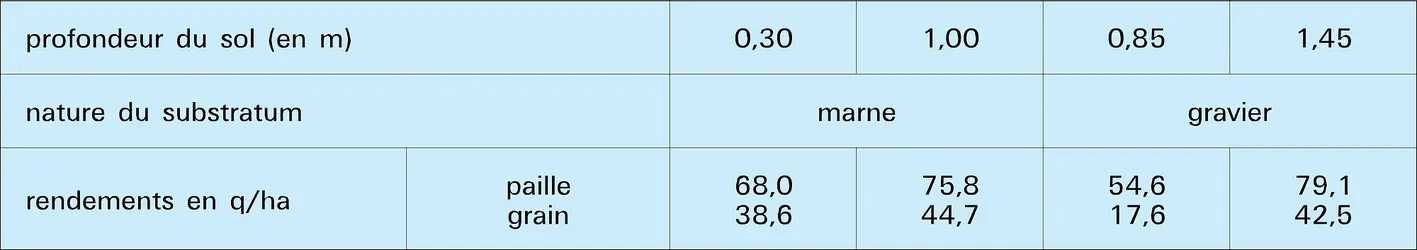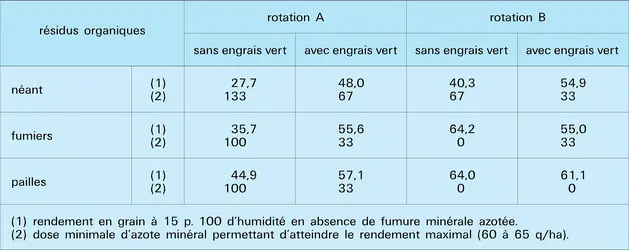FERTILITÉ DES SOLS
Lorsqu'on s'interroge sur le sens du substantif « fertilité » ou de son adjectif dérivé « fertile », la première idée qui vient généralement à l'esprit est celle d'un niveau de production utile. Cela traduit des résultats tangibles, concrets. Un sol fertile apparaît donc en premier lieu comme un sol fécond, c'est-à-dire un sol qui produit d'abondantes récoltes.
Mais cette acception concrète conduit parfois à des ambiguïtés flagrantes. Considérons, par exemple, le cas d'une parcelle homogène qui, lors d'une succession, serait partagée entre deux héritiers agriculteurs d'inégale valeur professionnelle. Il est alors hautement probable que la productivité ( le rendement) des deux fractions parcellaires sera très rapidement différenciée. Envisageons ensuite le cas de diverses variétés d'une même plante cultivée qui, possédant chacune leurs caractères propres d'activité photosynthétique, de résistance au froid ou aux maladies parasitaires, conduisent à des rendements fort différents dans un même milieu pédoclimatique. Faut-il conclure de ces deux exemples que la fertilité des parcelles mises en comparaison n'est pas la même ? Ou doit-on penser que la fertilité de l'une est plus mal – ou moins bien – exprimée que celle de l'autre ? On en vient alors à attribuer à la fertilité un autre sens, abstrait, celui de capacité de production, ou encore d'une faculté ou d'une aptitude à produire.
Entre ces deux acceptions – la concrète et l'abstraite – qui, dans la réalité, sont souvent convergentes, même le recours aux meilleurs dictionnaires laisse l'esprit indécis. Car l'acception concrète est attribuée au substantif « fertilité », ou à son synonyme « fécondité », tandis que l'autre est attribuée au qualificatif « fertile ». Aussi convient-il, comme le font les linguistes, de s'en remettre à l'usage qui admet l'une et l'autre.
À la vérité, cette double acception est jugée bien nécessaire pour qui connaît, par expérience ou par savoir, la multiplicité des facteurs de production et, par conséquent, la difficulté d'apprécier une aptitude par voie de synthèse. À une telle notion synthétique, abstraite, difficile à transcrire en chiffres se substitue donc souvent celle que concrétise sa réalisation matérielle, c'est-à-dire la production effective.
Au travers de la littérature sur ce sujet, une évolution semble s'être dessinée, qui a progressivement remplacé la notion de production par celle d'aptitude à produire. Il faut probablement en rechercher les causes dans le progrès des sciences agronomiques et dans celui de leur transcription concrète : les techniques agricoles. Ayant analysé de manière de plus en plus poussée les facteurs de production et les ayant de mieux en mieux maîtrisés, les agronomes ont ainsi perfectionné leurs capacités à porter un jugement synthétique sur l'aptitude à produire du milieu pédoclimatique. Maintenant, pour la plupart des agronomes, la fertilité est devenue l'expression d'une potentialité.
Les facteurs de la fertilité
Quel que soit le parti adopté sur l'extension du mot, la fertilité apparaît comme la résultante, réelle ou théorique, d'effets multiples et interdépendants caractéristiques du milieu géographique (climat et sol), ainsi que de l'action de l'homme (techniques culturales).
En fonction de ces deux groupes de facteurs, certains ont distingué la fertilité naturelle, liée au premier, et la fertilité acquise, due au second. En raison de la maîtrise grandissante de l'homme sur les éléments naturels, une telle distinction perd peu à peu de son intérêt. D'autant plus qu'en toute rigueur la première ne peut guère s'appliquer qu'aux régions où le climat, la faune et la flore ne sont pas soumis directement[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Louis GACHON : ingénieur agronome, docteur ès sciences, directeur de recherche, chef du département d'agronomie de l'Institut national de la recherche agronomique
Classification
Pour citer cet article
Louis GACHON. FERTILITÉ DES SOLS [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
AGRICULTURE - Histoire des agricultures jusqu'au XIXe siècle
- Écrit par Marcel MAZOYER, Laurence ROUDART
- 6 086 mots
- 2 médias
...ont pris de l'ampleur avec la houe métallique, qui a permis de défricher des tapis herbacés denses après brûlage des herbes en fin de saison sèche. Quant au renouvellement de la fertilité de ces terres cultivées, il a été assuré de diverses manières. Dans les zones à bétail, les plus nombreuses (Sahel,... -
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
- Écrit par Céline CRESSON, Claire LAMINE, Servane PENVERN
- 7 882 mots
- 6 médias
La gestion de la fertilité des sols s’appuie sur l’usage de la fumure organique, celle des animaux (fumier) mais aussi celle des déchets organiques compostés. Elle repose en premier lieu sur la diversification des pratiques culturales : des rotations pluriannuelles avec l’introduction de cultures... -
AGRONOMIE
- Écrit par Stéphane HÉNIN, Michel SEBILLOTTE
- 9 202 mots
- 1 média
...trouver le premier agronome au sens moderne du terme, car il tente d'établir un système de l'agriculture, s'efforçant en outre de définir la notion de « fertilité », c'est-à-dire l'aptitude à produire. Cette dernière était considérée comme une propriété inhérente au sol, et non, comme on l'a montré depuis,... -
AMMONIFICATION ou AMMONISATION
- Écrit par Didier LAVERGNE
- 1 920 mots
- 1 média
...qui rejette dans l'ombre la complexité des phénomènes minéralisateurs. Leur méconnaissance a cependant causé des déboires, dans diverses tentatives de fertilisation : épandage des eaux résiduelles, utilisation de certains engrais azotés, reconversion d'herbages, amélioration des sols forestiers.... - Afficher les 7 références
Voir aussi