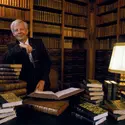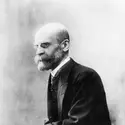CHANGEMENT SOCIAL
Le changement dans les sociétés est un fait aussi banal et aussi peu contestable que leur relative stabilité. La sagesse des nations l'exprime de deux manières : les Grecs disaient qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, et le Français remarque : « Plus ça change, plus c'est la même chose. »
Ces lapalissades ne vaudraient pas d'être citées si elles ne se prêtaient à une élaboration qui met en forme leur contenu, et leur substitue un champ d'application et de validité à peu près défini. Toute connaissance part de données intuitives, sur lesquelles l'esprit s'efforce de construire un ensemble de relations significatives et vérifiables. Le succès ne sanctionne pas toujours ces entreprises, qui sont d'autant plus hasardeuses que les données à traiter sont plus complexes et plus confuses. Mais leur richesse même nous provoque à ne pas nous contenter de l'état brut dans lequel elles nous sont livrées par le sens commun.
La sociologie, telle qu'elle se constitue au xixe siècle, se donne pour première tâche d'énoncer les lois du changement social. Auguste Comte ouvre son Cours de philosophie positivepar la fameuse loi des trois états. La même préoccupation de réduire à une seule loi la dynamique de toutes les sociétés humaines est tout aussi sensible chez le dernier grand évolutionniste du xixe siècle, Herbert Spencer. Le souci de saisir l'enchaînement des grandes phases de l'évolution humaine apparaît également chez Marx, et peut-être surtout chez Engels.
Quant à la nature du changement social, à l'identification rigoureuse de ses phases les plus caractéristiques, ces penseurs s'en font les conceptions les plus diverses. Comte tend à assimiler les étapes du progrès spirituel (à la fois scientifique et moral) aux types d'organisation sociale. Spencer, de son côté, a popularisé l'opposition entre les sociétés militaires et les sociétés industrielles. Marx et les marxistes accordent le plus grand intérêt aux « rapports de production », dont ils cherchent à décrire et à expliquer les associations avec les autres aspects de la vie sociale.
Pour ces hommes du xixe siècle, non seulement la société est changement (ce qui est incontestable), mais les formes de ce changement sont réductibles à une expression unique qui se développe à travers le temps (ce qui apparaîtra de plus en plus douteux, au fur et à mesure que l'analyse sociologique gagnera en finesse et en rigueur). De ce deuxième point de vue naissent des difficultés probablement insolubles, mais dont l'examen a beaucoup enrichi la réflexion sociologique. Admettons que les « idées mènent le monde » (pour parler comme Auguste Comte), ou inversement, et pour reprendre un des énoncés fondamentaux de Marx, supposons que « les rapports de production » déterminent les superstructures juridiques, politiques, idéologiques, scientifiques. Si peu qu'on réfléchisse, on s'aperçoit que la nature du pouvoir causal attribué aux « idées » ou aux « rapports de production reste tout aussi mystérieuse dans le second énoncé que dans le premier. Mais, en cherchant à préciser le sens de termes comme « mener » ou « déterminer », la réflexion sociologique se met en mesure de progresser sur plusieurs points essentiels. D'abord, elle est amenée à poser le problème de l'efficacité des idées et des représentations : comment ? à travers quels canaux ? utilisant quels appuis et quels relais ? surmontant ou contournant quels obstacles, une découverte scientifique, une idée, un système philosophique nouveau sont-ils susceptibles de produire des effets appréciables et imputables dans tel secteur de la vie sociale ? Corrélativement, elle est conduite à rechercher comment ces nouveautés, ces innovations s'insèrent dans le contexte des besoins explicites ou latents, ce qu'elles doivent aux circonstances, au milieu, au[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- François BOURRICAUD : professeur à l'université de Paris-IV-Sorbonne
Classification
Pour citer cet article
François BOURRICAUD. CHANGEMENT SOCIAL [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Média
Autres références
-
ACCULTURATION
- Écrit par Roger BASTIDE
- 8 306 mots
- 1 média
...classiques de variations concomitantes, d'absence et de présence, de Stuart Mill), pour observer les effets qui vont se produire, en suivant le processus de changement tout au long de son cours, et en « évaluant » les résultats terminaux. Seulement, le facteur « dominateur » hypothétique n'était pas le même... -
ANNALES ÉCOLE DES
- Écrit par Bertrand MÜLLER
- 3 324 mots
- 1 média
L'action de Febvre et de Bloch s'était déployée dans uncontexte singulier de crises qui avaient affecté des sociétés confrontées à une modernisation rapide, et n'épargnaient ni les sciences sociales, incapables de s'institutionnaliser, ni l'histoire, confrontée à une crise à la fois morale – issue... -
ANOMIE
- Écrit par Raymond BOUDON
- 4 002 mots
- 1 média
Lathéorie durkheimienne de l'anomie convient donc admirablement à l'analyse des transplantations, c'est-à-dire aux situations où l'individu se trouve placé devant des systèmes de règles conflictuelles engendrant une situation de démoralisation, caractérisée par une absence de cadres de conduite stable.... -
ANTHROPOLOGIE
- Écrit par Élisabeth COPET-ROUGIER, Christian GHASARIAN
- 16 158 mots
- 1 média
...l'Afrique noire (1955) s'orientèrent vers une anthropologie dynamique qui, se distinguant de la démarche intellectualiste, posa les questions du changement social, de la transition et du développement. Les sociétés froides sont entrées depuis longtemps dans l'histoire cumulative et elles doivent... - Afficher les 78 références
Voir aussi