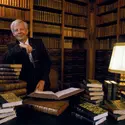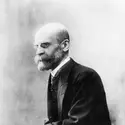CHANGEMENT SOCIAL
Changement et développement
Les économistes et les sociologues modernes (Colin Clark, Fourastié, Rostow) qui ont étudié les phases du développement économique, en s'attachant surtout à définir les conditions du « décollage », c'est-à-dire du passage d'une économie traditionnelle à une économie moderne, ont cherché à saisir les mécanismes de transfert par lesquels glissent, du secteur primaire (agriculture et mine) au secondaire (industrie) et au tertiaire (services), des populations qui y trouvent un emploi plus productif. Mais, à l'origine de ces mouvements, on trouve des phénomènes de refoulement (hors des zones déprimées, excédentaires, et en tout cas relativement mal loties) et d'attraction (vers les zones où le travail « rend » mieux). Ce sont bien les facteurs démographiques, techniques et économiques qui sont présentés par les auteurs modernes, autant que par les classiques des xviie, xviiie et xixe siècles comme la source et le moteur du changement social.
Densité et anomie
Mais Durkheim enrichit cette analyse sur un point essentiel. Ce ne sont pas les relations de coût et de revenu (grâce auxquelles s'établissent des comparaisons en termes de productivité entre les différents emplois), ou le rapport global entre les subsistances et la population qui doivent seulement retenir l'attention du sociologue. Ces différents éléments n'agissent que médiatement. C'est ce que montre très bien Durkheim dans sa célèbre distinction entre la « densité matérielle et la densité spirituelle » d'une société. Supposons que la population se soit, pour une cause ou pour une autre, brusquement accrue ; imaginons ensuite, comme c'est actuellement le cas dans beaucoup de pays sous-développés, qu'une partie de cette population émigre des champs, où elle est excédentaire, vers des emplois industriels (soit parce que les terres sont devenues rares, soit parce qu'ayant été ruinées par un usage continu et immodéré elles ne sont plus en mesure d'entretenir les agriculteurs). Il en résultera, dans certains cas, un extraordinaire accroissement des villes, comme on peut le voir de nos jours en Amérique latine. Ce qui intéresse le sociologue dans le processus d' urbanisation, c'est de saisir comment à travers les bouleversements dans le mode de logement, de transport, de consommation, l'exposition à des moyens de communication indirects (presse, radio, télévision, qui se substituent aux face à face de la société traditionnelle), les rapports sociaux se trouvent modifiés : comment subsiste, par exemple, ou, au contraire, se dissout l'institution familiale, qui, dans les communautés paysannes numériquement étroites et relativement closes, obtenait de ses membres un conformisme strict par le jeu des contrôles continus et personnalisés ? En posant ainsi la question, le sociologue attire l'attention, non pas seulement sur la densité matérielle de la société urbaine, mais sur sa densité spirituelle, c'est-à-dire la fréquence, l'intensité, la nature des contacts qu'elle établit entre ses membres.
Lorsque cette densité est très faible, c'est-à-dire lorsque les contacts entre les individus cessent d'être réglés (par des rythmes collectifs, et surtout par la participation à des valeurs communes), on peut, avec Durkheim, parler d'anomie.
Cette notion permet de définir un moment caractéristique dans le processus de changement social, surtout lorsque celui-ci a été produit par l'intrusion d'un facteur exogène, comme un accroissement marqué de population, associé (comme il est probable et très fréquent) à des changements dans les rapports de productivité. C'est le phénomène qui se produit en Europe, au moment de la première révolution industrielle, et auquel les penseurs socialistes ont cherché à fournir à la fois une explication et un remède.[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- François BOURRICAUD : professeur à l'université de Paris-IV-Sorbonne
Classification
Pour citer cet article
François BOURRICAUD. CHANGEMENT SOCIAL [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Média
Autres références
-
ACCULTURATION
- Écrit par Roger BASTIDE
- 8 306 mots
- 1 média
...classiques de variations concomitantes, d'absence et de présence, de Stuart Mill), pour observer les effets qui vont se produire, en suivant le processus de changement tout au long de son cours, et en « évaluant » les résultats terminaux. Seulement, le facteur « dominateur » hypothétique n'était pas le même... -
ANNALES ÉCOLE DES
- Écrit par Bertrand MÜLLER
- 3 324 mots
- 1 média
L'action de Febvre et de Bloch s'était déployée dans uncontexte singulier de crises qui avaient affecté des sociétés confrontées à une modernisation rapide, et n'épargnaient ni les sciences sociales, incapables de s'institutionnaliser, ni l'histoire, confrontée à une crise à la fois morale – issue... -
ANOMIE
- Écrit par Raymond BOUDON
- 4 002 mots
- 1 média
Lathéorie durkheimienne de l'anomie convient donc admirablement à l'analyse des transplantations, c'est-à-dire aux situations où l'individu se trouve placé devant des systèmes de règles conflictuelles engendrant une situation de démoralisation, caractérisée par une absence de cadres de conduite stable.... -
ANTHROPOLOGIE
- Écrit par Élisabeth COPET-ROUGIER, Christian GHASARIAN
- 16 158 mots
- 1 média
...l'Afrique noire (1955) s'orientèrent vers une anthropologie dynamique qui, se distinguant de la démarche intellectualiste, posa les questions du changement social, de la transition et du développement. Les sociétés froides sont entrées depuis longtemps dans l'histoire cumulative et elles doivent... - Afficher les 78 références
Voir aussi