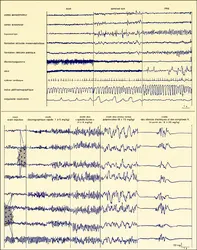ANESTHÉSIE
Rôle du médecin anesthésiste
Le médecin anesthésiste est responsable de la conduite de l'anesthésie. Son activité s'exerce d'abord lors de la consultation préanesthésique, ensuite au bloc opératoire pendant l'anesthésie, et au décours dans la salle de surveillance postopératoire (« salle de réveil »). Le médecin anesthésiste intervient également en cas de complication postopératoire et détermine la stratégie de prise en charge de la douleur postopératoire.
La consultation préanesthésique est un moment essentiel qui a pour but d'évaluer le risque anesthésique et opératoire, en fonction des pathologies dont souffre le patient et des traitements qu'il suit et qui sont susceptibles d'interférer avec le déroulement de l'anesthésie. Cette consultation permet de définir la technique d'anesthésie qui sera utilisée.
Le risque anesthésique comprend notamment le risque d'intubation difficile et celui d'accident allergique. L'intubation difficile, qui peut conduire à des difficultés de ventilation, peut être prédite par l'étude de critères anatomiques lors de la consultation préanesthésique. Cette consultation permet de choisir les techniques d'intubation adaptées. Le risque allergique, en partie imprévisible, est cependant augmenté quand le patient présente certains antécédents : la consultation préanesthésique permet au médecin anesthésiste de s'informer de ces antécédents allergiques. Par exemple, l'allergie au latex peut être soupçonnée quand il existe des antécédents d'allergie alimentaire au kiwi ou à la banane, ou lorsque le patient exerce une profession exposée (contraignant à la manipulation de gants en latex). Les principaux agents responsables d'accidents allergiques sont les curares, les colloïdes et les antibiotiques utilisés en peropératoire.
La consultation préanesthésique sert aussi à informer le patient du déroulement et des conséquences de l'anesthésie, des complications encourues, de la prise en charge de la douleur postopératoire, de l'éventualité d'une transfusion sanguine peropératoire et de ses conséquences.
Le médecin anesthésiste travaille en équipe. Chaque médecin peut prendre en charge une étape ou la totalité du déroulement des actes pré-, per- et post-anesthésie. La continuité des soins pour un même patient est assurée par des procédures rigoureuses de transmission d'informations.
La pratique de l'anesthésie est entourée de précautions qui ont pour objectif d'éviter la survenue d'accidents. Les décisions de choix thérapeutiques, mais aussi l'organisation même du travail, sont imprégnées par l'idée du risque, omniprésent dans les esprits lors de la réalisation de tout acte anesthésique. La pratique de l'anesthésie au bloc opératoire répond de ce fait de plus en plus à des pratiques prédéfinies et périodiquement contrôlées par des procédures de type « assurance-qualité ». L'application de ces procédures est le meilleur garant d'un accroissement de la sécurité des patients confiés aux médecins anesthésistes.
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Francis BONNET : professeur d'anesthésie-réanimation
- François CHAST : pharmacien des hôpitaux, chef du service pharmacologie-toxicologie de l'Hôtel-Dieu, Paris
Classification
Pour citer cet article
Francis BONNET et François CHAST. ANESTHÉSIE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
ANESTHÉSIE : PREMIÈRES DÉMONSTRATIONS
- Écrit par François CHAST
- 243 mots
Le 30 mars 1842, à Jefferson (Georgie, États-Unis), un patient, du nom de John Venables, souffrant d'un abcès au cou, est opéré sans douleur grâce à l'emploi d'éther, par Crawford Long (1815-1878). L'intervention ne sera rapportée que sept ans plus tard.
Le 11 décembre...
-
ACÉTYLÈNE
- Écrit par Henri GUÉRIN
- 5 089 mots
- 6 médias
L'acétylène, qui n'est pas toxique, présente des propriétés anesthésiques. On l'utilise surtout en Allemagne et aux États-Unis (narcylène) en anesthésie générale dans un mélange oxygéné à 30 ou 40 p. 100 au début de l'anesthésie puis à 60-70 p. 100 par la suite. L'anesthésie est... -
ANTISEPSIE ET ASEPSIE
- Écrit par Gabriel GACHELIN
- 587 mots
- 1 média
Classiquement, l’histoire de la chirurgie est scandée par deux dates : l’année 1846, au cours de laquelle l’anesthésie à l’éther est utilisée pour la première fois ; l’année 1867, au cours de laquelle le chirurgien britannique Joseph Lister (1827-1912) décrit le succès d’une...
-
BARBITURIQUES
- Écrit par A. M. HAZEBROUCQ
- 1 036 mots
Composés organiques dérivant de la malonylurée improprement appelée acide barbiturique en raison de la forme de ses cristaux « semblables à une lyre » (barbitos), les barbituriques constituent un groupe homogène tant sur le plan chimique que sur le plan pharmacologique. Leur action...
-
CHIRURGIE
- Écrit par Claude d' ALLAINES, Jean-Édouard CLOTTEAU, Didier LAVERGNE
- 8 668 mots
- 5 médias
En moins d'un demi-siècle, trois découvertes capitales vont profondément transformer l'exercice de la chirurgie. Celle de l'anesthésie à partir de 1846, celle de l'antisepsie à partir de 1867, puis celle de l'asepsie à partir de 1886. - Afficher les 14 références
Voir aussi
- TENSION ARTÉRIELLE
- NEUROPHARMACOLOGIE
- PRESSION SANGUINE
- RISQUE THÉRAPEUTIQUE
- OPÉRATION CHIRURGICALE
- NERFS
- ANESTHÉSIQUES LOCAUX
- HALOGÉNÉS ANESTHÉSIQUES
- OPIACÉS MÉDICAMENTS
- KOLLER CARL (1857-1944)
- NIEMANN ALBERT (1834-1861)
- PÉRIDURALE ANESTHÉSIE
- XYLOCAÏNE ou LIDOCAÏNE
- NARCOSE
- PROTOXYDE ou HÉMIOXYDE D'AZOTE
- NARCOTIQUES
- ANALGÉSIE
- HYPNOTIQUES ou SOMNIFÈRES
- CURARE & CURARISANTS
- INTUBATION
- SOINS INTENSIFS
- RESPIRATION
- RESPIRATION ASSISTÉE ou ASSISTANCE RESPIRATOIRE
- SÉDATIFS
- MÉDECINE HISTOIRE DE LA
- INJECTIONS LOCALES, médecine
- BENZODIAZÉPINES
- MONITORAGE ou MONITORING
- PROPOFOL ou 2,6-DIISOPROPYLPHÉNOL