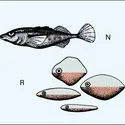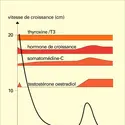PHOTOPÉRIODISME
Le photopériodisme, qui traduit l'influence de la durée du jour et de la nuit sur diverses réactions physiologiques, est un phénomène important, répandu aussi bien dans le monde animal que dans le monde végétal. La diapause des insectes et l'activité hormonale des oiseaux chez les animaux (cf. insectes, reproduction), de même que la floraison, la tubérisation, la chute des feuilles ainsi que la dormance des bourgeons des végétaux, dépendent de la durée de l'éclairement.
La découverte du photopériodisme remonte à 1912, lorsque J. Tournois montra que le chanvre et le houblon fleurissent mieux si la durée du jour est courte. Puis, en 1920, W. Garner et H. Allard aux États-Unis établissent plus précisément les bases du photopériodisme en montrant que le tabac (Nicotiana tabacum Maryland Mammoth) ne fleurit qu'en journée courte. Ces mêmes auteurs démontrent l'effet d'un éclairement faible de lumière blanche (quelques dizaines de lux) donné au cours de la nuit pour empêcher la floraison du soja.
Le photopériodisme apparaît comme un « remarquable processus régulateur de la floraison » et a reçu de ce fait diverses applications en horticulture (P. Chouard).
Besoins des plantes en lumière
De nombreuses observations écologiques et physiologiques ont permis de classer les plantes en trois groupes selon la quantité de lumière nécessaire à leur floraison : les plantes de jour long ou héméropériodiques ; les plantes de jour court ou nyctipériodiques ; les plantes indifférentes au photopériodisme.
Vis-à-vis du photopériodisme de jour long ou de jour court, les plantes peuvent avoir des exigences absolues ou être seulement préférentes.
Les plantes héméropériodiques ou nyctipériodiques absolues demandent respectivement des durées quotidiennes d'éclairement ou d'obscurité au-dessous desquelles elles ne fleurissent pas (P. Chouard) ; on définit ainsi des héméropériodes critiques et des nyctipériodes critiques.
Il est important de souligner que, si un éclairement faible suffit à assurer une réponse photopériodique, les plantes exigent d'abord un éclairement suffisamment intense d'une durée minimale (environ 8 à 9 heures sous les latitudes tempérées) qui assure une bonne vigueur végétative de la plante : c'est le minimum trophique d'éclairement ; la valeur de l'éclairement pendant cette période trophique influence fortement les réponses des plantes. Les définitions des caractéristiques photopériodiques ne sont donc valables que dans des conditions climatiques de culture voisines de celles des conditions naturelles ; il est possible au laboratoire, dans des chambres climatisées, de perturber ou même d'inverser les réponses au photopériodisme, mais ces résultats ne remettent pas en cause pour autant la classification des plantes vis-à-vis du photopériodisme.
De plus, il est montré, depuis les études de E. Bünning, que les plantes manifestent vis-à-vis de la lumière un certain rythme de sensibilité : par cycle de 24 heures, à une photophase (période de sensibilité à la lumière) succède une scotophase (période d'insensibilité) ; ce rythme, initialement déclenché par l'alternance de la lumière et de l'obscurité, est ensuite entretenu par la plante et devient un rythme endogène qui se manifeste à différentes étapes du métabolisme. Ainsi, un éclairement faible fourni pendant la nuit n'a pas la même activité photopériodique selon qu'il est donné au début, au milieu ou à la fin de la nuit (R. Jacques). Des études biochimiques ont permis de préciser la relation entre les rythmes endogènes et l'alternance des jours et des nuits perçue par la plante.
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Roger JACQUES : sous-directeur d'institut de recherche au C.N.R.S., sous-directeur du laboratoire du phytotron à Gif-sur-Yvette
Classification
Pour citer cet article
Roger JACQUES. PHOTOPÉRIODISME [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
COMPORTEMENT ANIMAL - Fondements du comportement
- Écrit par Dalila BOVET
- 2 830 mots
- 5 médias
Sous des latitudes moyennes, c'est généralement laphotopériode, c'est-à-dire la longueur relative du jour et de la nuit, qui déclenche ces comportements saisonniers. En laboratoire, il est possible, en allongeant artificiellement la durée du jour, de stimuler les comportements liés à la reproduction... -
CROISSANCE, biologie
- Écrit par Universalis, André MAYRAT, Raphaël RAPPAPORT, Paul ROLLIN
- 14 760 mots
- 7 médias
...vaisseaux ligneux larges, alors que ces mêmes vaisseaux sont très étroits dans le bois formé à l'automne. Il existe également une rythmicité journalière. Si une plantule croissant en obscurité continue est exposée brusquement à la lumière, il en résulte des oscillations rythmiques de la vitesse de croissance.... -
DÉVELOPPEMENT, biologie
- Écrit par Georges DUCREUX, Hervé LE GUYADER, Jean-Claude ROLAND
- 19 221 mots
- 14 médias
Chez les plantes qui relèvent d'une induction photopériodique, l'approche expérimentale est plus aisée dans la mesure où elle peut être menée de façon quantitative. Cette approche est particulièrement évidente pour les plantes de jours longs comme la moutarde (Sinapis alba), utilisée encore... -
DIAPAUSE, zoologie
- Écrit par Catherine BLAIS, René LAFONT
- 1 154 mots
La diapause est une forme de vie ralentie, génétiquement déterminée, une phase d'arrêt du développement pendant des périodes défavorables de l'environnement. Cet important mécanisme adaptatif permet aux animaux de résister et de survivre aux variations saisonnières de l'habitat telles que les...
- Afficher les 11 références
Voir aussi