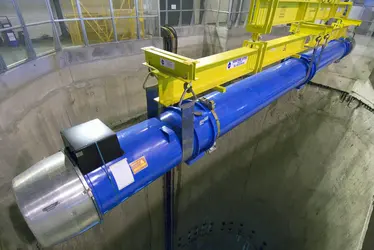MAGNÉTISME (notions de base)
- 1. Historique
- 2. Les lois classiques du magnétisme
- 3. Effet Hall
- 4. Aimants et électroaimants
- 5. Le géomagnétisme
- 6. Diamagnétisme et paramagnétisme
- 7. Ferromagnétisme, antiferromagnétisme et ferrimagnétisme
- 8. Le magnétisme, composant de l'électromagnétisme
- 9. Applications du magnétisme
- 10. Effets biologiques
- 11. Bibliographie
Diamagnétisme et paramagnétisme
La plupart des matériaux réagissent à la présence d’un champ magnétique H en acquérant une aimantation. En première approximation, l’aimantation est proportionnelle à l’excitation et on appelle susceptibilité magnétique χmle rapport de proportionnalité. Lorsque cette susceptibilité est négative (et en général très faible), on dit que le corps est « diamagnétique ». C’est le cas du carbone, du cuivre ou de l’eau. Un champ magnétique suffisamment intense peut faire léviter ces corps. On peut considérer les corps supraconducteurs comme des diamagnétiques parfaits ayant χm = — 1. Outre l’absence de résistance électrique au-dessous d’une température (souvent très basse) caractéristique, les corps supraconducteurs sont en effet caractérisés par le fait qu’ils expulsent le flux magnétique lorsqu’ils sont soumis à un champ extérieur. La lévitation de corps supraconducteurs soumis à un champ magnétique est un phénomène spectaculaire. Cet « effet Meissner », du nom de Walther Meissner qui l’a découvert en 1933, est dû à l’apparition de courants électriques d’écrantage qui circulent à la surface du matériau et produisent un champ électrique qui annule exactement le champ extérieur.
D’autres matériaux – le chrome, l’oxygène, l’aluminium par exemple – ont une susceptibilité magnétique positive mais faible (de l’ordre d’un cent millionième). Cette propriété est appelée « paramagnétisme ». La magnétisation des corps dia- ou paramagnétiques disparaît lorsqu’on éloigne la cause de leur aimantation.
- 1. Historique
- 2. Les lois classiques du magnétisme
- 3. Effet Hall
- 4. Aimants et électroaimants
- 5. Le géomagnétisme
- 6. Diamagnétisme et paramagnétisme
- 7. Ferromagnétisme, antiferromagnétisme et ferrimagnétisme
- 8. Le magnétisme, composant de l'électromagnétisme
- 9. Applications du magnétisme
- 10. Effets biologiques
- 11. Bibliographie
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Bernard PIRE : directeur de recherche émérite au CNRS, centre de physique théorique de l'École polytechnique, Palaiseau
Classification
Pour citer cet article
Bernard PIRE. MAGNÉTISME (notions de base) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Média
Voir aussi
- MATÉRIAUX SCIENCE DES
- MOTEURS ÉLECTRIQUES
- COURANT ÉLECTRIQUE ALTERNATIF
- CHAMP ÉLECTRIQUE
- CHAMP MAGNÉTIQUE
- ÉLECTROTECHNIQUE
- SUSCEPTIBILITÉ MAGNÉTIQUE
- PARAMAGNÉTISME
- FERROMAGNÉTISME
- HYSTÉRÉSIS
- CHAMP DÉMAGNÉTISANT
- DÉSAIMANTATION
- AIMANTATION
- DOMAINE, magnétisme
- CURIE POINT ou TEMPÉRATURE DE
- ANTIFERROMAGNÉTISME
- MATÉRIAUX MAGNÉTIQUES
- COURANT ÉLECTRIQUE
- MÉMOIRES MAGNÉTIQUES, informatique
- DISQUE DUR, informatique
- FERRIMAGNÉTISME
- FARADAY LOIS DE
- MAGNÉTIQUE ENREGISTREMENT
- BANDE MAGNÉTIQUE
- SUPPORT D'INFORMATION
- FORCE, physique
- FOUCAULT COURANTS DE
- LAPLACE LOIS DE
- CHAMP ÉLECTROMAGNÉTIQUE
- INDUCTION MAGNÉTIQUE
- HALL EFFET
- SOLIDES PHYSIQUE DES
- PÔLES MAGNÉTIQUES, géomagnétisme
- DIPÔLE, magnétisme
- INVERSION DU CHAMP MAGNÉTIQUE TERRESTRE
- CHAMP MAGNÉTIQUE TERRESTRE ou CHAMP GÉOMAGNÉTIQUE
- ÉLECTRODYNAMIQUE QUANTIQUE
- BOBINES ÉLECTRIQUES
- MEISSNER EFFET
- WEBER, unité
- TESLA, unité
- GAUSS, unité
- RELATIVITÉ RESTREINTE
- VAN ALLEN CEINTURES DE
- IRM (imagerie par résonance magnétique) ou RMN (résonance magnétique nucléaire), applications biomédicales
- PHYSIQUE HISTOIRE DE LA
- SCIENCES HISTOIRE DES
- GÉODYNAMO