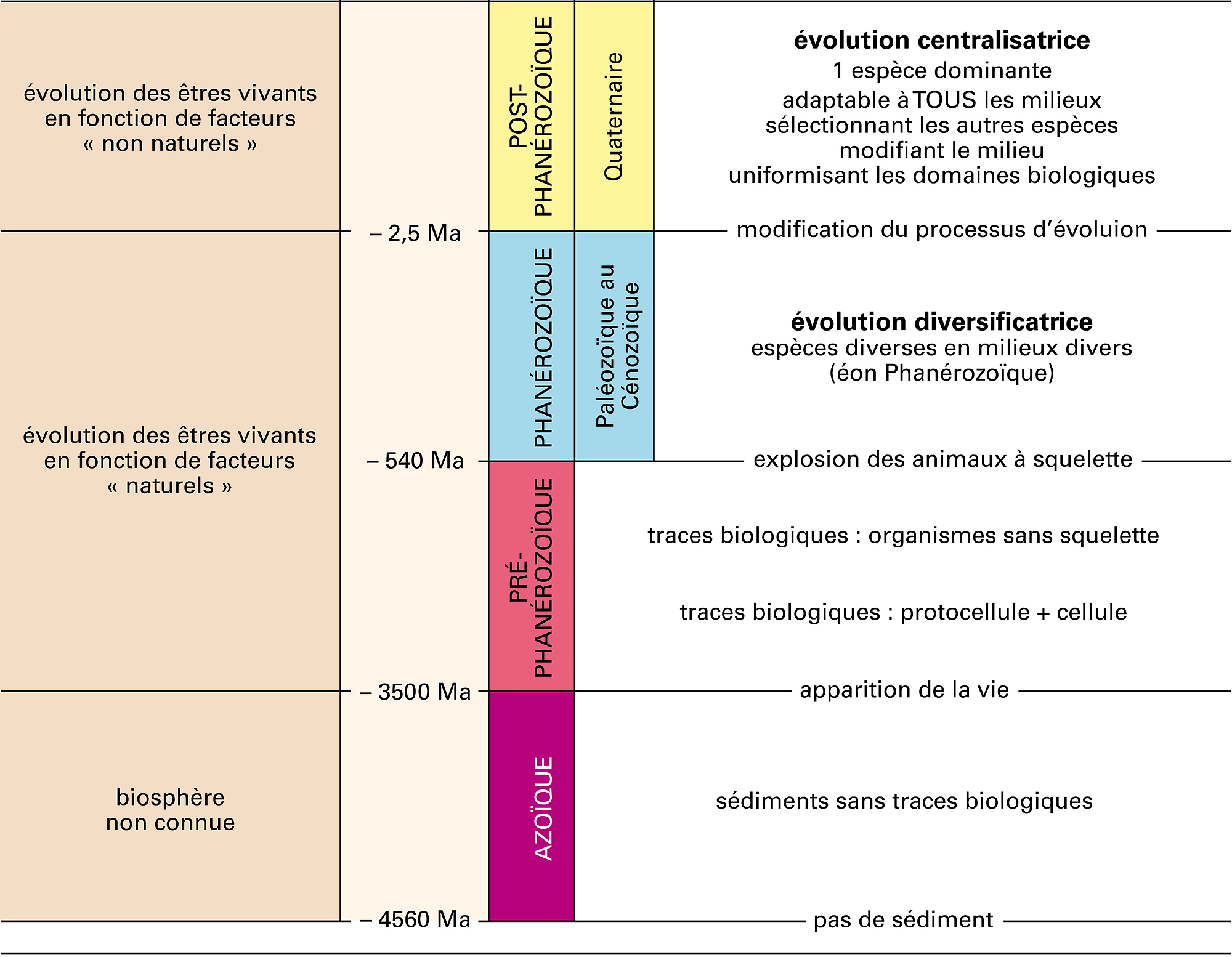STRATIGRAPHIE
La stratigraphie (du latin stratum, « couche », et du grec graphein, « écrire ») a pour objectif, commun à d'autres disciplines géologiques, de retracer l'histoire de la planète. Pour cela, elle étudie l'agencement dans l'espace et la situation dans le temps des couches externes de la planète. Les strates, ou couches géologiques, ont enregistré, lors de leur formation, les multiples caractéristiques de leur environnement proche et/ou lointain. Ces strates correspondent aux pages d'un livre écrites en langages divers et que l'on tente de décrypter. Leur étude débouche sur des considérations environnementales (reconstitution des milieux), chronologiques (corrélation et position dans le temps) et paléogéographiques (reconstitution des paysages). Le stratigraphe est historien et géographe des roches (lithosphère) mais aussi de l'hydrosphère, de l'atmosphère et de la biosphère sur la Terre, voire sur d'autres planètes.
La stratigraphie est une science en voie de renouvellement. En effet, elle étudie aujourd'hui les séries sédimentaires avec une approche plus diversifiée et plus globale que par le passé, le terme « global » faisant référence à l'étude des phénomènes à l'échelle de la planète. Ce renouveau crée des nécessités : une approche par des outils multiples, dont il résulte une stratigraphie dite intégrée ; un consensus sur les objectifs, dont l'ambition peut être la prédiction des changements futurs proches ou lointains ; une coordination des données acquises sur les domaines émergés avec les données recueillies dans les bassins océaniques actuels, rendus accessibles par des techniques nouvelles. Les résultats ainsi obtenus, appliqués aux sédiments émergés, ont notablement enrichi la connaissance.
La stratigraphie est pluridisciplinaire car elle combine des connaissances et des raisonnements à diverses échelles, depuis l'ensemble sédimentaire (le bassin de dépôt) jusqu'à l'isotope. Plusieurs domaines scientifiques (géologie, géophysique, astronomie, physique, chimie, mathématiques) sont mis à contribution. Dans chacun d'eux, diverses disciplines sont impliquées (par exemple, sédimentologie, paléontologie, tectonique, volcanologie, pétrographie, etc., pour la géologie). Enfin, ces connaissances sont acquises par l'utilisation de techniques d'analyse dont les résultats sont traités par des procédés intuitifs, logiques ou mathématiques.
Le stratigraphe travaille sur le terrain, soit en surface sur des affleurements de couches dans les coupes naturelles (réalisées par les phénomènes d'érosion) ou artificielles (carrières, bords des routes), soit sur des prélèvements par sondage (sondages géologiques carottés à terre ou en mer), soit par observation indirecte (investigation sismique).
Formation des strates
Facteurs qualitatifs
La formation des terrains géologiques met en jeu un agent de production, un agent de transport et un milieu de dépôt. Chacun d'eux imprime son empreinte dans la roche qui se constitue. Les strates formées permettront au stratigraphe des reconstitutions environnementales fondées sur la reconnaissance de ces empreintes.
Le milieu le plus répandu de mise en place des strates est le milieu océanique au fond duquel s'accumulent les sédiments marins. L'océan intervient encore comme agent de transport mais aussi comme siège d'une production non négligeable d'éléments sédimentaires (tests carbonatés, phosphatés, siliceux). Les sédiments peuvent être constitués de particules solides provenant de l'érosion : ce sont les sédiments détritiques (sable, argile détritique) ; ils peuvent provenir de l'accumulation de produits issus de réactions chimiques (sels, oxydes, hydroxydes, carbonates, voire silicates comme les argiles authigènes c'est-à-dire formées sur place)[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Gilles Serge ODIN : directeur de recherche au C.N.R.S.
Classification
Pour citer cet article
Gilles Serge ODIN. STRATIGRAPHIE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Article mis en ligne le et modifié le 10/02/2009
Médias
Autres références
-
STÉNON INVENTE LA STRATIGRAPHIE
- Écrit par Florence DANIEL
- 254 mots
- 1 média
Dès 1667, le savant danois Niels Steensen (1638-1686) – en français Nicolas Sténon – introduit dans un ouvrage d'anatomie les notions et les termes de « strates » et de « sédiments ». Selon lui, les couches du sous-sol sont d'anciens sédiments qui se sont peu à peu déposés au fond de l'eau et indurés,...
-
TERRE - Planète Terre
- Écrit par Jean AUBOUIN et Jean KOVALEVSKY
- 9 225 mots
- 9 médias
De l'étude des strates – ce sera la stratigraphie – naît unechronologie relative, chaque couche étant reconnue comme plus récente que celle qu'elle surmonte et plus ancienne que celle qui lui est superposée. On sut ainsi reconnaître le plus ancien du plus récent, mais sans en avoir la mesure... -
ARCHIAC ADOLPHE DESMIER DE SAINT-SIMON vicomte d' (1802-1868)
- Écrit par Myriam COHEN
- 372 mots
Géologue français. Préparé par ses études à une carrière militaire, il quitte l'armée en 1830 pour se consacrer entièrement à la géologie.
Les premiers travaux de d'Archiac ont été des monographies régionales précises et détaillées. Il a d'abord fait une Description...
-
BASSIN SÉDIMENTAIRE
- Écrit par Roger COQUE
- 4 704 mots
- 6 médias
...diversement combinées selon les cas, constituent un matériel rocheux dont l'épaisseur peut atteindre plusieurs milliers de mètres (de 3 000 à 4 000 m). Leur stratigraphie offre des lacunes d'importance variable accompagnées ou non de discordances angulaires. Il peut s'agir de sédiments de mers épicontinentales... -
CAMBRIEN
- Écrit par Alain BLIECK
- 1 173 mots
Cambrien est le nom donné, au xixe siècle, par Adam Sedgwick à une série stratigraphique du nord du pays de Galles. Ce nom vient de Cambria/Cumbria, formes latines du mot celte qui désigne cette région. Le Cambrien correspond au premier système de l'ère paléozoïque (ère primaire)...
- Afficher les 52 références