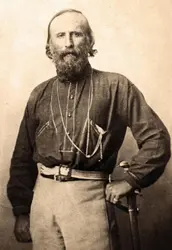MERCENAIRES
Le mercenariat définit une fonction militaire ou paramilitaire assurée en contrepartie d'un salaire, comme le révèle l'origine latine du mot (merces, salaire). Assurée par des spécialistes de la guerre, cette activité repose sur des contingents privés prêts à louer leurs services au plus offrant, sans aucune vue patriotique commune. La rémunération peut être relativement faible, pour un métier traditionnellement exercé au profit d'une puissance étrangère et qui, dans l'histoire, se révèle souvent ingrat.
Apparu dès l'Antiquité, le mercenariat n'a cessé de se développer pour connaître son âge d'or, en Occident, de la fin du Moyen Âge jusqu'au xviie siècle. À cette époque, les mercenaires, souvent issus de pays relativement pauvres ou morcelés, représentent la principale force armée pour le pouvoir politique. Ces professionnels de la guerre lui sont indispensables lorsque de véritables armées permanentes font défaut. Leur fidélité repose essentiellement sur un contrat par lequel un salaire leur est versé en échange de leurs services. Leur rôle est par conséquent d'une importance capitale avant la consolidation des États-nations et la constitution d'armées nationales qui ont entraîné leur quasi-disparition à la fin de l'époque moderne. En effet, la conscription et le développement de l'idéal patriotique, à partir des révolutions américaine et française, ont permis de recourir à des effectifs militaires de plus en plus importants. La formation de contingents, le maintien de troupes de conscrits sous les drapeaux offrent, en permanence, les éléments armés destinés à la protection du territoire national et des intérêts de l'État.
Pourtant, après une éclipse de près de deux siècles, le mercenariat reparaît dans la seconde moitié du xxe siècle sous une forme entrepreneuriale, par le biais des sociétés militaires privées (SMP). Il devient récurrent dans les crises inter- ou intra-étatiques, dans un monde où les frontières entre guerre ouverte et guerre secrète sont de plus en plus floues. Cette résurgence invite à porter sur le phénomène un regard historique large, des âges antiques jusqu'à l'actualité tumultueuse du début du xxie siècle.
De l'Antiquité à l'époque moderne
Les grands empires, tout au long de l'Antiquité, ont recours aux services de mercenaires qui sont plus ou moins confondus avec les troupes auxiliaires. On leur reconnaît compétences techniques et prouesses dans la maniabilité des armes les plus récentes. Souvent, ils deviennent indispensables pour les souverains soucieux d'asseoir leur puissance.
Mercenaires-auxiliaires de l'Antiquité
En Égypte, sous l'Ancien Empire (2815-2400), les pharaons s'appuient, en l'absence d'armées permanentes, sur des contingents nationaux mais surtout sur des combattants issus des peuples conquis ou soumis, tels les Nubiens et les Libyens. D'autres nations influent sur l'évolution de l'armement et des techniques militaires. C'est le cas notamment des Hyksôs, peuple ouest-sémitique d'origine nomade, peut-être en majorité des Amorrites, qui, de conquérants, deviennent soumis et contribuent à l'adoption, dans l'armée du pharaon, du cheval et du char, sources de renforcement du potentiel tactique.
Comme les Égyptiens, les Phéniciens, les Perses ou les colonies grecques d'Ionie en Asie Mineure sauront recourir aux troupes mercenaires. Les cités libres de la Grèce procèdent de manière similaire. La Crète et l'Arcadie sont alors considérées comme de véritables réservoirs de guerriers. Les techniques de combat nécessitent un long apprentissage, notamment le maniement des armes de jet. Le mercenariat permet de disposer quasi instantanément d'une force armée composée d'hommes endurants autant qu'expérimentés. Ces soldats d'[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pascal LE PAUTREMAT : docteur en histoire, enseignant en histoire et géographie, en géopolitique et défense intérieure
Classification
Pour citer cet article
Pascal LE PAUTREMAT. MERCENAIRES [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
ABDALLAH ABDERAMANE AHMED (1919-1989)
- Écrit par Marie-Françoise ROMBI
- 977 mots
Premier chef d'État des Comores, Ahmed Abdallah est né le 12 juin 1919 sur la côte est de l'île d'Anjouan, dans l'aristocratie de Domoni, selon sa biographie officielle. Mais divers portraits du chef du Parti vert (de la couleur des bulletins de vote) le décrivent plutôt comme un paysan madré...
-
ARMÉE - Typologie historique
- Écrit par Paul DEVAUTOUR, Universalis
- 12 926 mots
- 21 médias
Les armées mercenaires sont des armées de métier, généralement à base d'étrangers, soit de même nationalité, soit de nationalités mêlées, qui vendent leurs services, selon contrat, à un prince ou à un État. Il en est ainsi dans l'Antiquité, surtout aux phases d'impérialisme, en Orient et en Extrême-Orient... -
CELTES
- Écrit par Christian-Joseph GUYONVARC'H, Pierre-Yves LAMBERT, Stéphane VERGER
- 15 826 mots
- 5 médias
L'intégration des nouveaux arrivants est facilitée par le fait qu'ils constituent une puissance militaire à craindre, ou bien à exploiter. Déjà dans la première moitié du ive siècle, des mercenaires celtiques sont engagés par Denys de Syracuse. Certains établissements, comme Ancône sur l'Adriatique,... -
COMORES
- Écrit par Universalis, Marie-Françoise ROMBI
- 4 939 mots
- 4 médias
Dansla nuit du 12 au 13 mai 1978, un commando de cinquante mercenaires européens, conduits par le « colonel » Bob Denard, capture Ali Soilih, disperse l'« armée populaire » et prend le contrôle du pays, préparant le retour d'Ahmed Abdallah (21 mai), suivi de l'assassinat d'Ali Soilih (28 mai). Trait... - Afficher les 15 références
Voir aussi
- EUROPE, histoire
- DIX MILLE EXPÉDITION DES
- GUERRE DROIT DE LA
- CIA (Central Intelligence Agency)
- ARMÉE, histoire
- BRIGADES INTERNATIONALES
- ÉGYPTE, histoire : l'Antiquité
- SOCIÉTÉS MILITAIRES PRIVÉES (SMP)
- GRÈCE, histoire, Antiquité
- PERSE, histoire : Antiquité
- ITALIE, histoire, de 476 à 1494
- AFRIQUE NOIRE, histoire, des indépendances à nos jours
- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours
- ROME, l'Empire romain
- URSS, histoire
- CONFLIT ARMÉ
- PRIVATISATION