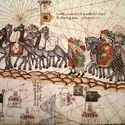MING LES, dynastie chinoise (1368-1644)
Après avoir chassé de Chine le régime mongol, les Ming seront eux-mêmes supplantés par un pouvoir d'origine non chinoise, la dynastie mandchoue des Qing. Le destin de cette dernière dynastie « nationale » présente maints aspects du classique « cycle dynastique » : née des rébellions suscitées par un régime oppressif et corrompu, fondée par un chef de guerre pouvant se targuer d'avoir recueilli le mandat céleste, confrontée, après une phase initiale de reconstruction, à des difficultés de tous ordres qui, en dépit d'une tardive reprise en main, finiront par provoquer un nouvel embrasement et par l'emporter...
Aux origines de la dynastie des Ming, le mouvement messianique des Turbans rouges qui se dresse contre le pouvoir mongol à partir de 1351. L'un des chefs rebelles, Zhu Yuanzhang, installe sa base à Nankin (1356), d'où il conquiert l'empire en une douzaine d'années et où il se proclame empereur en 1368 avec le nom de règne de Hongwu. Son petit-fils Jianwen (règne de 1398 à 1402), qui lui succède, entend rendre le gouvernement au pouvoir civil et enlever leur pouvoir à ses oncles, apanagés par Hongwu dans des fiefs frontaliers. L'un de ces derniers se soulève à Pékin et, après quatre ans de guerre civile, s'empare du trône avec pour nom de règne Yongle (règne de 1403 à 1424). Il transfère la capitale à Pékin (1421), où elle demeurera jusqu'à la fin de la dynastie, Nankin restant capitale secondaire. Le Grand Canal, réaménagé, est le lien vital entre les riches provinces du Sud et les centres politiques et stratégiques du Nord. Au régime encore très militariste de Yongle (qui conduit personnellement cinq expéditions contre les Mongols) succèdent des gouvernements beaucoup plus « confucéens » et favorables à la bureaucratie lettrée, même si les institutions du despotisme impérial mises en place par Hongwu sont conservées. Mettant un terme aux grandes expéditions maritimes lancées par Yongle, ses héritiers adoptent une politique de repli sur les frontières et prohibent le commerce outre-mer. L'affaiblissement militaire de la dynastie est mis en évidence lorsque les Mongols s'emparent de l'empereur Zhengtong, qui s'est laissé entraîner à la tête d'une expédition contre leur chef Esen Khan (1449). Les Mongols restent une menace potentielle et parfois pressante (ils assiègent Pékin en 1550) jusqu'au traité conclu en 1570 avec Altan Khan, et c'est pour se préserver d'eux que les Ming ont reconstruit la Grande Muraille. La « fermeture maritime » est pour une bonne part à l'origine des raids de « pirates japonais » (wokou) qui ravagent les provinces du Sud-Est (1553-1564), beaucoup de ces Japonais étant en fait des contrebandiers chinois. Les victoires de généraux Ming comme le fameux Qi Jiguang, ainsi que la légalisation du commerce maritime (1567), mettent un terme à l'épisode. Intervenant au moment même où la présence occidentale s'affirme en Extrême-Orient (les Portugais sont admis à Macao en 1557), la réouverture des côtes a un impact considérable sur l'économie et la société de la Chine du bas Yangzi et du Sud-Est : développement rapide du commerce et de l'artisanat, spécialisation agricole, urbanisation... Les rentrées d'argent en provenance du Japon et de l'Amérique espagnole via les Philippines sont à l'origine de la monétarisation accélérée de l'économie et de la fiscalité, et leur tarissement, à la fin des années 1630 et au début des années 1640, provoquera une grave récession.
Pourtant celle-ci n'est qu'un des facteurs qui entraîneront la chute des Ming, et que n'auront su prévenir les efforts d'assainissement entrepris sous la direction du grand secrétaire Zhang Juzheng entre 1568 et 1582. On citera pêle-mêle les affrontements politiques qui se succèdent depuis[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre-Étienne WILL : directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales
Classification
Pour citer cet article
Pierre-Étienne WILL. MING LES, dynastie chinoise (1368-1644) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
DYNASTIE MING
- Écrit par Pascal BURESI
- 226 mots
À partir de 1351, la dynastie mongole des Yuan, qui règne sur la Chine, est fortement contestée : des soulèvements populaires, auxquels se rallient les élites, embrasent leur Empire et aboutissent à l'avènement de la dernière dynastie impériale d'origine chinoise, les Ming. Le fondateur de la dynastie,...
-
DYNASTIE MING - (repères chronologiques)
- Écrit par Pascal BURESI
- 348 mots
1368 Le rebelle Zhu Yuanzhang s'empare de Pékin, capitale de la dynastie mongole des Yuan, et fonde la dynastie des Ming, en prenant le nom de règne de Hongwu.
1380 Première d'une longue série de purges : procès de Hu Weiyong, compagnon de lutte de Hongwu ; quinze mille personnes sont jugées...
-
ACHÈVEMENT DE LA GRANDE MURAILLE DE CHINE
- Écrit par Alain THOTE
- 247 mots
- 1 média
La Grande Muraille fut achevée sous les Ming par un dernier tronçon construit au nord de Lanzhou (Gansu) en 1598. C'était l'aboutissement d'une entreprise ayant connu de très longues périodes d'interruption, mais commencée dès l'époque des Printemps et des Automnes (vers — 500) par les Chinois pour...
-
CHINE - Histoire jusqu'en 1949
- Écrit par Jean CHESNEAUX, Jacques GERNET
- 44 594 mots
- 50 médias
...xive siècle. La Chine de la Huai et la vallée du Yangzi échappent bientôt à leur contrôle et l'un des chefs de rébellion, Zhu Yuanzhang, fonde à Nankin en 1368 le nouvel Empire des Ming. C'est, depuis les environs de 200 avant notre ère, le premier exemple d'insurrection populaire qui aboutisse... -
CHINOISE (CIVILISATION) - Bureaucratie, gouvernement, économie
- Écrit par Pierre-Étienne WILL
- 10 991 mots
...(si l'on excepte le cas particulier de la dynastie mongole) ont su éviter ce dernier péril. Les circuits (dao) des Song comme les provinces (sheng) des Ming sont administrés collégialement par plusieurs hiérarchies parallèles : fiscale, judiciaire, militaire, parfois aussi censoriale, de telle sorte que... -
CHINOISE CIVILISATION - Les arts
- Écrit par Corinne DEBAINE-FRANCFORT, Daisy LION-GOLDSCHMIDT, Michel NURIDSANY, Madeleine PAUL-DAVID, Michèle PIRAZZOLI-t'SERSTEVENS, Pierre RYCKMANS, Alain THOTE
- 54 368 mots
- 37 médias
La nouvelle dynastie chinoise qui prit le nom de Ming voulut se rattacher à la tradition des Tang. L'empereur Yongle (1403-1424) établit la capitale à Pékin qu'il embellit de palais, de terrasses de marbre et de jardins. - Afficher les 25 références
Voir aussi