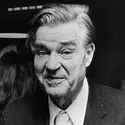CONJONCTURE
Le mot conjoncture désigne à la fois l'ensemble des faits constitutifs de la situation économique du proche passé et du proche avenir et la méthode d'analyse de ces faits. Le mot évoque en même temps les faits économiques concrets qui résultent des états donnés de la nature ou du libre comportement des agents économiques, mais il inclut aussi les faits du hasard ou de l'imprévisible. Le mot conjoncture évoque enfin l'action au présent, l'actualité.
Dans les diverses significations du mot, deux paraissent essentielles : c'est d'abord tout ce que recouvre l'interaction entre le libre arbitre des agents économiques et les circonstances où ils sont placés : il n'y a pas de conjoncture dans le fonctionnement des machines, fussent-elles les plus ingénieuses, ou dans la vie des insectes sociaux car, fondamentalement, il ne se développe de conjoncture que là où existe la possibilité de faire des choix. La même idée se retrouve dans les autres acceptions de ce terme : conjoncture politique ou conjoncture sociale par exemple. En second lieu, la conjoncture se développe dans le présent. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un présent totalement dénué d'épaisseur : observer les comportements et les faits demande quelques délais ; les comprendre impose un peu de mise en perspective à la fois rétrospective et prévisionnelle. Mais cette prévision ne cherche pas à atteindre les tendances longues du futur, cette mise en perspective ne déborde pas sur le domaine de l'historien.
Les faits concrets de la conjoncture sont de plusieurs types. Il s'agit d'abord des états donnés du monde, qu'ils soient ou non prévisibles : la situation démographique ou les aléas climatiques par exemple. Viennent ensuite les faits qui résultent de décisions prises assimilables à des commandes : les décisions économiques des gouvernements relèvent de ce cas. Mais la grande masse des faits qu'étudie la conjoncture sont ceux qui résultent du comportement des agents économiques, en interaction avec ces états du monde et ces décisions. L'analyse de la conjoncture consiste alors à relier entre eux ces états, ces décisions, ces situations concrètes pour percer la logique de leur déroulement, en comprendre le sens et tenter d'en prévoir l'évolution. Les séries statistiques fournissent l'expression numérique de ces faits ; parce que la dimension temporelle est courte, c'est une statistique fréquente : mensuelle ou trimestrielle, quelquefois hebdomadaire. La science économique offre des références permettant de représenter les comportements des agents et le cadre théorique dans lequel ces comportements s'articulent entre eux. Aussi, la conjoncture en tant que méthode apparaît-elle relever de l'économie pour ses théories et de la statistique pour ses techniques d'observation.
Analyse au jour le jour de l'économie vivante, la conjoncture a l'ambition de comprendre et de prévoir. Au « diagnostiquer et pronostiquer » qu' Alfred Sauvy, fondateur de la science conjoncturelle en France, emprunte au langage du médecin répond le « décrire, expliquer, prévoir » de son élève André L. Vincent. Ces cinq mots résument la méthode et l'objectif de la conjoncture.
La conjoncture et son environnement
Cet effort pour décrire, expliquer et prévoir la situation conjoncturelle n'a pas pour seul motif le désir de connaissance. En effet, les agents économiques dont les comportements sont l'objet de l'analyse conjoncturelle sont aussi intéressés par le résultat de cette étude. Acteurs d'un jeu dans lequel ils font des choix, ils sont aussi observateurs du jeu, attentifs à utiliser la liberté de décisions qu'ils y possèdent pour améliorer la satisfaction ou le profit qu'ils en retirent. La conjoncture répond à un besoin : mieux régler son comportement face à une situation[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Philippe NASSE : maître de conférence à l'Ecole poly-technique, chef du service de la conjoncture à l'I.N.S.E.E.
Classification
Pour citer cet article
Philippe NASSE. CONJONCTURE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Autres références
-
ANTICIPATIONS, économie
- Écrit par Christian de BOISSIEU
- 6 072 mots
- 4 médias
...directe des anticipations est à la fois indispensable et délicate. Elle suppose en général une quantification des résultats qualitatifs obtenus grâce aux enquêtes de conjoncture. Ainsi, en matière d'inflation, l'I.N.S.E.E. pose aux ménages français, dans le cadre d'enquêtes de conjoncture, une question... -
ÉCONOMIE (Définition et nature) - Objets et méthodes
- Écrit par Henri GUITTON
- 6 478 mots
...économique concrète, réelle : la mise en forme des mouvements historiques de telle ou telle économie. Cette cinématique manifeste ce qu'on appelle aussi la conjoncture. Sans doute, sous ce terme riche de sens divers, pense-t-on d'abord à la prévision des mouvements futurs, à la manière dont seront conjointes... -
EXPANSION ÉCONOMIQUE
- Écrit par Bernard DUCROS
- 3 687 mots
À l'époque contemporaine, néanmoins, c'est beaucoup plus le risque inverse qui est à craindre, à savoir le risque d'emballement de la conjoncture. L'expansion tend à entraîner une « surchauffe » de l'appareil de production. -
INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques)
- Écrit par Jean-Michel REMPP
- 578 mots
Le développement de la statistique démographique, économique et sociale conduit tout naturellement à celui des services correspondants ; selon les pays, le système statistique est plus ou moins décentralisé, plus ou moins limité à la seule production statistique ou orienté davantage vers la prévision...
Voir aussi