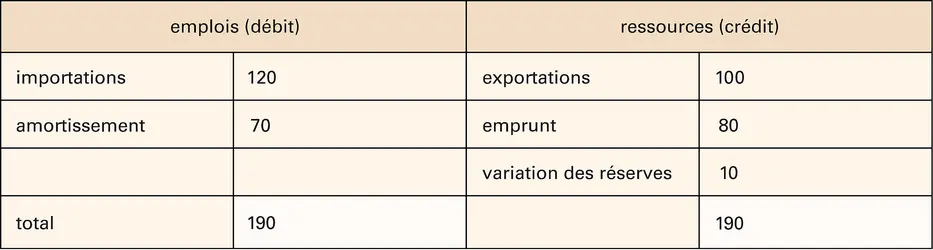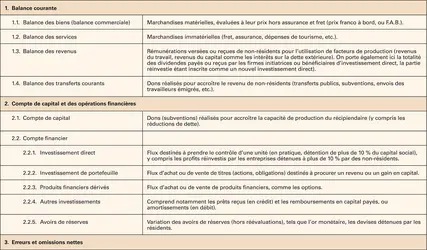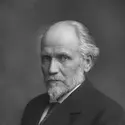PAIEMENTS BALANCE DES
Position extérieure nette
Des flux aux encours
Jusqu'ici, nous avons présenté la balance des paiements en termes de flux, qui enregistre les transactions au cours d'une année donnée, comme par exemple les emprunts effectués chaque année à l'extérieur. Ainsi se constitue une dette extérieure, dont il est intéressant de connaître le montant (encours) à un moment donné (pour le comparer, par exemple, au montant des réserves de change). C'est la raison pour laquelle le F.M.I. préconise l'élaboration de « balances des paiements » en termes d'encours (« position extérieure nette »), c'est-à-dire à un moment donné. Cela n'a pas de sens pour les postes de la balance courante. Il faut se limiter aux actifs, financiers ou non. Il s'agit de présenter d'un côté tous les actifs « non-résidents » détenus par les résidents, et inversement. On évaluera par exemple l'encours de la dette extérieure « nette » (dette vis-à-vis de non-résidents moins les créances sur les non-résidents), ainsi que l'encours des investissements directs à l'étranger (moins l'encours des investissements des non-résidents dans l'économie considérée), les encours nets de titres détenus, etc.
Des encours aux flux potentiels
L'élaboration de la position extérieure nette permet de mieux apprécier l'importance de flux potentiels (par exemple les flux qui pourraient se produire en cas de retrait massif des investisseurs non-résidents. Toutefois, il est difficile de valoriser les encours (à leur valeur historique ? à leur valeur de marché ?), et surtout d'établir une relation entre les variations d'encours et les flux.
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Marc RAFFINOT : maître de conférences à l'université de Paris-Dauphine
Classification
Pour citer cet article
Marc RAFFINOT. PAIEMENTS BALANCE DES [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
AN ENQUIRY INTO THE NATURE AND EFFECTS OF THE PAPER CREDIT OF GREAT BRITAIN, Henry Thornton - Fiche de lecture
- Écrit par Jérôme de BOYER
- 1 032 mots
...est suspendue, un déficit de la balance des paiements provoque une baisse sensible du taux de change qui fait monter le prix de marché de l'or. Il aborde alors la question des origines du déficit de la balance des paiements et soutient que celui-ci peut provenir aussi bien de causes réelles (mauvaises... -
ARGENTINE
- Écrit par Jacques BRASSEUL, Universalis, Romain GAIGNARD, Roland LABARRE, Luis MIOTTI, Carlos QUENAN, Jérémy RUBENSTEIN, Sébastien VELUT
- 37 033 mots
- 18 médias
...autant. Le pouvoir d'achat démesuré des Argentins est un puissant frein à l'industrialisation, car il devient moins onéreux d'importer que de produire. Il en résulte un profond déséquilibre de la balance commerciale, obligeant l'État, via la Banque nationale, à acheter massivement sa propre monnaie afin... -
CHANGE - Les théories du change
- Écrit par Hélène RAYMOND-FEINGOLD
- 9 106 mots
- 1 média
L'approche traditionnelle du taux de change par la balance des paiements conçoit le taux de change avant tout comme une variable d'ajustement, permettant d'atteindre l'équilibre externe. Dans les versions les plus simples de cette approche, le taux de change réel – défini comme le rapport du taux de... -
CHANGE - Les régimes de change
- Écrit par Patrick ARTUS
- 6 907 mots
- 5 médias
Le déroulement de la crise du S.M.E. est riche d'enseignements que l'on retrouve dans le modèle théorique dit de « crise des balances des paiements » : - Afficher les 20 références
Voir aussi
- CAPITAL COMPTE DE
- FINANCEMENT
- OR, économie et finances
- BALANCE COMMERCIALE
- DEVISE, économie et finances
- INSTABILITÉ FINANCIÈRE
- CHANGE FIXE
- ENDETTEMENT
- AUTORÉALISATION, économie
- CHANGE FLOTTANT ou FLEXIBLE ou FLOTTEMENT MONÉTAIRE
- MONÉTAIRES RÉSERVES
- EXPORTATIONS
- IMPORTATIONS
- BALANCE, comptabilité
- CRÉANCES & DETTES
- PENSÉE ÉCONOMIQUE HISTOIRE DE LA
- CLASSIQUE ÉCOLE, économie
- RELATIONS ÉCONOMIQUES INTERNATIONALES