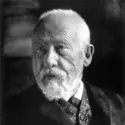DILTHEY WILHELM (1833-1911)
Explication et compréhension
On ne saurait saisir la teneur du projet diltheyen sans cerner la portée de cette distinction, reprise par Max Weber, entre explication et compréhension. « Nous expliquons la nature, nous comprenons la vie psychique » : elliptique, la célèbre formule peut égarer. En réalité, Dilthey ne réduit nullement l'histoire à la compréhension. Les objets de l'historien, situés dans l'espace et le temps, font eux aussi partie de la nature et se trouvent soumis à ses lois, à commencer par le principe de causalité. Toutefois, les phénomènes historiques, tout en partageant la soumission de la nature au déterminisme, sont aussi des phénomènes signifiants ; comme tels, ils évoquent l'idée d'une causalité intentionnelle, celle des acteurs sociaux dont il faudrait, pour cerner cette dimension du sens, reconstituer les choix, sédimentés dans l'historicité. Ce pourquoi, en tant que la réalité historique, effet de causes antécédentes, présente aussi des « effets de sens », la démarche cognitive devra articuler explication et compréhension : une approche compréhensive doit venir compléter l'investigation causale dès lors que l'objet ne relève pas seulement de la nature, mais s'inscrit dans ce que Dilthey désigna comme « monde de l'esprit ». Au demeurant, la notion n'évoque ici nul « monde intelligible », ni un quelconque « univers nouménal », et renvoie simplement à cette sphère du sens qui est la trace de l'activité mentale (« spirituelle ») des sujets vivants et agissants.
Loin d'avoir privé les sciences sociales de leur légitime dimension explicative, Dilthey aura donc surtout insisté sur l'exigence d'y ménager, aux limites de l'explication, une place pour une démarche sans laquelle les sciences de l'homme, manquant la dimension du sens, manqueraient aussi leur objet. Néanmoins, la question de leur objectivité, si elle en est mieux délimitée (sur le versant explicatif, le subjectivisme n'est guère menaçant), n'en est pas pour autant résolue sur le versant compréhensif.
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Sylvie MESURE : docteur en sociologie, chargée de recherche au C.N.R.S.
Classification
Pour citer cet article
Sylvie MESURE. DILTHEY WILHELM (1833-1911) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Média
Autres références
-
COMPRÉHENSION (sociologie)
- Écrit par Isabelle KALINOWSKI
- 903 mots
C’est au sein des sciences humaines allemandes de la seconde moitié du xixe siècle que la notion de compréhension a été formulée pour la première fois par l’historien Johann Gustav Droysen puis par le philosophe Wilhelm Dilthey. Elle est d’emblée définie en référence à un dualisme des...
-
CRITIQUE LITTÉRAIRE
- Écrit par Marc CERISUELO, Antoine COMPAGNON
- 12 918 mots
- 4 médias
...philologique de Schleiermacher, conforme au positivisme français, postulait que la reconstruction du contexte d'origine était possible et suffisante, Dilthey et surtout Husserl voient dans toute œuvre la manifestation d'une conscience. La tâche du critique est de retrouver cette conscience, comme... -
HERMÉNEUTIQUE
- Écrit par Jean GREISCH
- 3 294 mots
- 3 médias
...conquiert ainsi un statut philosophique. Alors que Friedrich Schleiermacher (1768-1834) y voit encore une simple « science auxiliaire » de la philosophie, Wilhelm Dilthey (1833-1911) va lui accorder une dimension philosophique intrinsèque, en montrant le rôle central que les notions d'interprétation et de... -
HISTORICITÉ
- Écrit par Hans Georg GADAMER
- 6 456 mots
- 3 médias
Dilthey, en tant qu'héritier de l'école historique, fut le premier à prendre conscience des conséquences philosophiques que contient cet héritage, et qui, avec l'idée du « droit naturel », mettaient aussi en question l'idée de la vérité intemporelle. Avec son ami le comte Ludwig Yorck von Wartenburg,... - Afficher les 9 références
Voir aussi