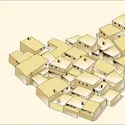PALÉOLITHIQUE
Spécialisation technique et spiritualisation. Paléolithique moyen
Au cours des deux premiers stades glaciaires du Würm (Würm I et Würm II), l'Europe connaît une spécialisation croissante des outillages avec une différenciation par régions géographiques. Tous appartiennent au stade moustérien du Paléolithique moyen. Les gisements moustériens sont bien plus nombreux que les gisements acheuléens, surtout si l'on pense que la durée du Moustérien (quelques dizaines de milliers d'années, de 80 000 à 35 000 ans avant notre ère) est beaucoup plus courte relativement que celle de l'Acheuléen (des centaines de milliers d'années). L'Afrique, siège des tout premiers débuts de l'hominisation, et où les industries à bifaces s'étaient d'abord bien développées, n'est plus le foyer du développement biologique et culturel ; celui-ci se déplace vers les latitudes les plus élevées, les pays actuellement tempérés de l'Eurasie. On s'est demandé ce qui avait déterminé ou facilité ce déplacement vers le nord : est-ce l'extension de l'usage du feu ? l'installation dans les grottes, où peut-être les Acheuléens ont vécu plus qu'on ne le pense ? On a supposé que steppes et toundra forestières de l'Europe froide pouvaient plus que toute autre formation végétale supporter un parc animal important, si bien que le régime carné des hommes de Neanderthal, largement assuré, leur permettait une expansion géographique et démographique et un développement culturel.
Outillage de l'homme de Neanderthal : les types moustériens
En Eurasie, les industries du Paléolithique moyen sont dues aux hommes de Neanderthal, Néanderthaliens classiques de l'Ouest et Néanderthaliens évolués de l'Est. C'est dans l'Europe de l'Ouest qu'ils sont le mieux connus, parce que les recherches y commencèrent au début du xixe siècle et qu'elles se sont constamment poursuivies soit dans des sites de plein air, soit dans des grottes et abris. On a appliqué en premier lieu les méthodes d'étude statistique à leurs outillages qui se présentent comme un vaste complexe industriel où cohabitent des groupes culturels distincts. Les mêmes types d'outils sont presque toujours fabriqués : pointes, racloirs de divers types, couteaux à dos, denticulés, encoches, raclettes. Le biface, outil roi de l'Acheuléen, s'y retrouve parfois. Le biface moustérien est grand et triangulaire dans les outillages anciens (Moustérien des plateaux) ; il est en forme de cœur dans la culture moustérienne où il est régulièrement répandu (Moustérien de tradition acheuléenne).
En France
En France, l'étude statistique des séries moustériennes du Nord et du Sud-Ouest a permis d'isoler dans ce vaste ensemble cinq groupes principaux (F. Bordes) : le Moustérien typique sans bifaces, à nombreux racloirs, avec pointes ; le Moustérien de tradition acheuléenne, avec bifaces cordiformes, couteaux à dos, racloirs, nombreux outils de type paléolithique supérieur ; le Moustérien de type Quina (Charente), à très nombreux racloirs, épais et arqués, latéraux ou transversaux, associés à des pièces bien spécialisées, les tranchoirs et les « limaces » ; le Moustérien de type Ferrassie (Dordogne), analogue au précédent, avec une très forte proportion de racloirs, mais qui est de débitage levalloisien, d'où l'aspect mince et allongé de son outillage, contrastant avec l'aspect massif et trapu de celui de la Quina ; enfin, le Moustérien à denticulés, où les outils sont rares, sauf les encoches et les denticulés.
F. Bordes a supposé que ces divers assemblages correspondent à des groupes culturels distincts, recevant et transmettant des traditions. En effet, dans un même site de grotte ou d'abri, des industries moustériennes différentes peuvent se succéder[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Denise de SONNEVILLE-BORDES : maître de recherche à la faculté des sciences de Bordeaux
Classification
Pour citer cet article
Denise de SONNEVILLE-BORDES. PALÉOLITHIQUE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Autres références
-
ACHEULÉEN
- Écrit par Michèle JULIEN
- 123 mots
L’Acheuléen est une civilisation de la préhistoire ; son nom vient du gisement de Saint-Acheul, faubourg d'Amiens, où fut découvert un outillage du Paléolithique inférieur dont la pièce caractéristique est le biface. Cette culture apparaît en France vers — 700 000, mais en Afrique...
-
AFRIQUE (Histoire) - Préhistoire
- Écrit par Augustin HOLL
- 6 326 mots
- 3 médias
La transition de l'Acheuléenau Paléolithique moyen s'étale sur près de 200000 ans, de 400000 à 200000 BP, quand les processus de régionalisation se déclenchent dans plusieurs parties du continent. Les hommes modernes apparaissent durant cette même période, suggérant une seconde migration hors d'Afrique.... -
ÂGE ET PÉRIODE
- Écrit par Jean-Paul DEMOULE
- 1 957 mots
...outre un stade de développement de l'humanité. Ce système est progressivement perfectionné. En 1865, dans Prehistoric Times, l'Anglais John Lubbock subdivise l'Âge de la pierre en un « Âge de la pierre ancienne » ou « Paléolithique » et un « Âge de la pierre nouvelle » ou « Néolithique ». Ami de... -
ANATOLIENNE PRÉHISTOIRE
- Écrit par Jacques CAUVIN, Marie-Claire CAUVIN
- 2 350 mots
- 3 médias
...et Nizip (près de Gaziantep), celui de Bozova (près d'Urfa), enfin celui de Keysun (région d'Adyaman). Si on y ajoute quelques trouvailles éparses au nord-est de la Turquie, le long du Caucase, on peut conclure à une occupation assez homogène de l'Anatolie auPaléolithique inférieur récent. - Afficher les 73 références
Voir aussi
- LEAKEY LOUIS SEYMOUR BAZETT (1903-1972)
- VÉRTESSZÖLLOS SITE PRÉHISTORIQUE DE
- CLACTONIEN
- KRAPINA SITE PRÉHISTORIQUE DE
- FERRASSIE LA, Dordogne
- INHUMATION
- ASIE DU SUD-EST
- GALETS, industrie lithique
- ASIE MINEURE
- PARIÉTAL ART
- POINTE, outillage préhistorique
- MAGDALÉNIEN
- PIERRE TAILLÉE ÂGE DE LA
- PIERRE POLIE ÂGE DE LA
- MOUSTÉRIEN
- MAS-D'AZIL SITE PRÉHISTORIQUE DU, Ariège
- FEU TECHNIQUES DU
- HOMINISATION
- PERCUTEUR, outillage préhistorique
- AFRIQUE, préhistoire
- MOBILIER ART, préhistoire
- PEINTURE, art préhistorique
- PITHÉCANTHROPE
- SINANTHROPE
- AUSTRALOPITHÈQUES
- RACLOIR, outillage lithique
- EXTRÊME-ORIENT, préhistoire et archéologie
- AURIGNACIEN
- FOYER, préhistoire
- PRESSION RETOUCHE PAR, industrie lithique
- OLDUVAI ou OLDOWAY SITE PRÉHISTORIQUE D', Tanzanie
- HABITAT PRÉHISTORIQUE
- TECHNIQUES HISTOIRE DES, préhistoire
- FOSSE, sépulture
- ABBEVILLIEN
- PÉRIGORDIEN
- ÉCLATS INDUSTRIES SUR, préhistoire
- OS INDUSTRIE DE L', préhistoire