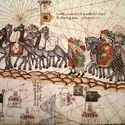JÉSUITES EN CHINE
Dans l'action des Jésuites en Chine (voir H. Bernard-Maître, art. « Chine » et « Chinois » in Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique ; J. Dehergne, Répertoire des Jésuites de Chine de 1552 à 1800, 1973), on peut distinguer trois périodes.
La première période, de 1552 à 1686, est celle du Padroado portugais. Paradoxalement, le monde chinois est abordé au Japon par François Xavier : « Si vous voulez aboutir, commencez par la Chine ! » Celle-ci ressortit au Padroado, installé à Macao (1557 ; évêché, 1576) ; le Patronato espagnol tient Manille (1571). L'Italien Ruggieri se laisse assimiler aux bonzes bouddhistes ; avec Matteo Ricci, il réussit à mettre pied, en 1583, à Zhaoqing et, en 1601, à Pékin. Avec beaucoup de prudence, il s'adresse aux lettrés, se heurte au problème des termes et à celui des rites. Le monopole jésuite est depuis peu entamé par les ordres venus de Manille au Fujian : les Dominicains en 1632, les Franciscains en 1633. Sur dénonciation d'un dominicain, la Congrégation pour la propagande de la foi condamne les méthodes de Ricci (1645). Mais le Saint-Office les confirme onze ans plus tard (1656). Quand la dynastie chinoise des Ming est renversée et remplacée par la dynastie sino-mandchoue des Qing (1644-1911), à la cour, l'Allemand Schall (1645) et le Flamand Verbiest (1659) continuent officiellement leur travail d'astronomes ; ils corrigent le calendrier impérial. Cependant, les pays européens se constituent des empires coloniaux ; les Pays-Bas s'implantent à Batavia, l'Angleterre aux Indes et la France à Pondichéry. battant en brèche l'hégémonie du Padroado. Le père Alexandre de Rhodes, Avignonnais venu du Vietnam, propose alors à Rome (1649) l'envoi d'évêques, des « vicaires apostoliques » (Mgr Pallu prend pied en Chine en 1684). Si la conception d'Église hiérarchique bénéficie du contexte sociopsychologique, ne heurtant pas les relations sociales traditionnelles, la Chine pourtant ne se convertit pas comme les Philippines, le Tonkin et (provisoirement) le Japon : elle n'a que 200 000 chrétiens, 159 églises jésuites, 21 dominicaines, 3 franciscaines, quand elle expulse les missionnaires à Canton (1724).
La deuxième période, de 1688 à 1775, correspond à l'Europe des Lumières. Cinq « mathématiciens du roi » (Louis XIV) arrivent à Pékin en 1688 ; la mission française est séparée de la vice-province portugaise en 1700. Si Kangxi accorde un édit de tolérance religieuse en 1692, Mgr Maigrot, vicaire apostolique du Fujian, condamne en 1693 la tradition de Ricci ; il est suivi en 1700 par la Sorbonne, en 1704 par le Saint-Office, en 1707 par le premier légat pontifical de Tournon, en 1715 et 1742 par les papes eux-mêmes. Boudée par les lettrés (« c'est le comble de l'incivilité, estiment-ils, que de ne pouvoir s'incliner devant les défunts »), l'Église ne s'adresse plus qu'aux petites gens. Elle subit des persécutions sous le règne de Yongzheng (1723-1736) et sous celui de Qianlong, de 1745 à 1748 et en 1784-1785. Les jésuites de la Cour travaillent à l'établissement des relations sino-russes (Pereira, Gerbillon) et au développement des sciences (astronomie, grande carte de la Chine, 1705-1719 ; estampes gravées « Conquêtes de Qianlong », 1754-1760), de l'architecture (le palais d'Été), de l'art (Castiglione, Attiret), de l'érudition (Parrenin, Gaubil, Amiot). Du Halde, éditeur des Lettres édifiantes, publie sa Description de la Chine (1735), dont Voltaire s'inspire. Mais, en 1762, le ministre portugais Pombal arrête les jésuites de Macao ; en 1764, Louis XV supprime la Compagnie en France ; Clément XIV, par un bref de 1773, la détruit ; le dernier ex-jésuite meurt, en 1813, après avoir publié la Bible en chinois et en mandchou.[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Joseph DEHERGNE : docteur de l'université de Paris, archiviste des Jésuites de la province de Paris
Classification
Pour citer cet article
Joseph DEHERGNE. JÉSUITES EN CHINE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Média
Autres références
-
CASTIGLIONE GIUSEPPE (1688-1766)
- Écrit par Michèle PIRAZZOLI-t'SERSTEVENS
- 997 mots
-
CHINE - Histoire jusqu'en 1949
- Écrit par Jean CHESNEAUX, Jacques GERNET
- 44 594 mots
- 50 médias
...pensée et des lettres chinoises à l'époque des Qing. En revanche, les influences étrangères ne paraissent pas avoir laissé de traces très profondes. Les jésuites, très actifs et bien accueillis à partir de l'arrivée à Pékin en 1601 de Matteo Ricci, introduiront dans les milieux lettrés des éléments de mathématiques,... -
CHINOISE (CIVILISATION) - La littérature
- Écrit par Paul DEMIÉVILLE, Jean-Pierre DIÉNY, Yves HERVOUET, François JULLIEN, Angel PINO, Isabelle RABUT
- 47 507 mots
- 3 médias
On peut se demander si et dans quelle mesure l'influence de l'Occident par l'intermédiaire des missionnaires jésuites a joué un rôle dans ce qu'on a pu appeler la « renaissance » chinoise de l'époque mandchoue. La plupart des historiens chinois sont enclins à la nier, tandis que certains auteurs occidentaux... -
CONDAMNATION DES RITES CHINOIS
- Écrit par Jean-Urbain COMBY
- 259 mots
Au xviie siècle, la Querelle des rites divise les missionnaires de la Chine et de l'Inde sur la désignation de Dieu dans les langues locales, sur l'adaptation des rites chrétiens, le baptême par exemple, sur l'acceptation ou le refus des rites traditionnels comme la vénération des ancêtres. Tandis...
- Afficher les 13 références
Voir aussi