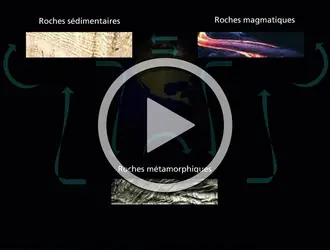ROCHES (Classification) Roches métamorphiques
Les principaux faciès minéraux, base d'une classification génétique
Après avoir introduit et développé la théorie des faciès minéraux, P. Eskola a défini, à l'aide d'associations minérales critiques propres à chaque faciès, les faciès minéraux principaux, dont le nombre s'est accru avec le progrès des études, est actuellement de huit. Rappelons qu'appartiennent au même faciès minéral toutes les roches métamorphiques, d'origine et de composition chimique variées, qui ont cristallisé, à l'équilibre ou à son voisinage, dans des conditions physiques définies. Les faciès minéraux principaux sont caractérisés comme suit.
Le faciès à zéolitespeut être scindé en deux sous-faciès : l'un, défini par l'association critique analcime + quartz ou la présence d'heulandite, marque le tout début du métamorphisme et fait la transition avec le domaine de la diagenèse ; l'autre, franchement métamorphique, est caractérisé par l'association critique laumontite + quartz, et le feldspath albite y est stable.
Le faciès à prehnite et à pumpellyite est défini par les associations critiques prehnite + quartz et pumpellyite + quartz avec ou sans épidote.
Le faciès des schistes verts est caractérisé par la stabilité de l'association amphibole calcique non alumineuse (actinote-trémolite) + plagioclase acide (albite ou oligoclase renfermant moins de 20 p. 100 d'anorthite). La biotite peut apparaître dans la zone la plus métamorphique de ce faciès.
Le faciès des schistes à glaucophane se distingue par la présence d'une amphibole sodique, le glaucophane. D'autres minéraux ou associations critiques, tels que lawsonite ou jadéite + quartz, permettent de définir des sous-faciès. La pumpellyite existe dans la partie la moins métamorphique du faciès, associée à la lawsonite. Le mica blanc est la phengite et la biotite n'y est pas stable.
Le faciès des amphibolites à albite et épidote est défini par l'association critique amphibole calcique alumineuse (hornblende) + plagioclase acide (An < 20 p. 100).
Le faciès des amphibolites est caractérisé par l'association critique hornblende + plagioclase (An > 20 p. 100).
Le faciès des granulites est défini, dans certaines roches quartzo-feldspathiques, par l'association critique orthopyroxène + plagioclase et par la présence obligatoire des grenats de la série almandin-pyrope.
Le faciès des cornéennes à pyroxène se distingue du précédent par l'absence des grenats de la série almandin-pyrope.
Le faciès des sanidinites est défini par la présence d'une série continue de feldspaths mixtes sodi-potassiques ( sanidine-albite, dite « de haute température »).
Le faciès des éclogites enfin a été caractérisé par Eskola à l'aide de l'association omphacite (clinopyroxène relativement riche en constituant jadéite) + grenat de la série almandin-pyrope (d'ailleurs souvent riche en constituant glossulaire). La disparition de la paragonite au profit du disthène, puis du quartz au profit de son polymorphe, la coesite, y indique des pressions atteignant respectivement de 15 à 20 et de 25 à 30 kbar.
Cette classification très générale constitue un moyen commode pour situer approximativement les roches métamorphiques dans le domaine température-pression, comme le montre la figure. Il faut cependant rappeler que le grand intérêt de la théorie des faciès minéraux n'est pas tant de classer les roches métamorphiques que de fournir une méthode inductive très souple et très fine pour l'étude des associations minérales naturelles, en particulier pour déceler les variations du métamorphisme sur le terrain.
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Gérard GUITARD : professeur de pétrographie à l'université de Paris-VI-Pierre-Marie-Curie
Classification
Pour citer cet article
Gérard GUITARD. ROCHES (Classification) - Roches métamorphiques [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
ACIDES ROCHES
- Écrit par Jean-Paul CARRON
- 426 mots
En pétrographie, on qualifie de « roches acides » celles qui contiennent plus de 65 p. 100 en poids du constituant SiO2 (la silice). Comme les minéraux les plus siliceux — à l'exception bien entendu du quartz — sont les feldspaths alcalins, pour lesquels la teneur en SiO2 est précisément...
-
ANDÉSITES ET DIORITES
- Écrit par Jean-Paul CARRON, Universalis, Maurice LELUBRE, René MAURY
- 2 066 mots
- 2 médias
C'est à l'abbé Haüy (Traité de géognosie de J. F. d'Aubuisson de Voisins, 1819), qui mettait ainsi l'accent sur la présence, dans ces roches plutoniques, de minéraux différant nettement les uns des autres par leur couleur, que les diorites doivent leur nom (du grec diorizô... -
ARGILES
- Écrit par Daniel BEAUFORT, Maurice PAGEL
- 2 654 mots
- 7 médias
Les argiles ont été utilisées très tôt dans l'histoire de l'humanité, après le silex et la pierre taillée. Ce matériau possède des propriétés plastiques particulières : facilement modelable, il peut être figé de façon irréversible, ce qui a permis les premières applications domestiques...
-
BASALTES ET GABBROS
- Écrit par Jean-Paul CARRON, Universalis, René MAURY
- 3 670 mots
- 2 médias
Les basaltes et les gabbros sont des roches magmatiques dont la composition chimique est très voisine. Basaltes et gabbros sont en effet intimement liés géographiquement puisqu'ils représentent les constituants largement majoritaires de la croûte océanique (ou « plancher océanique »). Schématiquement,...
- Afficher les 49 références
Voir aussi
- KINZIGITES
- PUMPELLYITE
- FUSION DES ROCHES
- CROISSANCE DES CRISTAUX
- CRISTALLISATION
- SKARNS
- QUARTZITES
- MINÉRAUX
- ISOGRADES
- PRASINITE
- SPILITES
- LEPTYNITES
- FOLIATION
- MÉTAMORPHIQUES ROCHES
- ICHOR
- MARBRES, roches
- FACIÈS MINÉRALOGIQUE D'ESKOLA
- GNEISS
- MICASCHISTES
- CATAZONE
- CORNÉENNES
- MÉTAMORPHISME
- PORPHYROBLASTES
- ENDOGÈNES ROCHES
- BLASTOMYLONITES
- ANATEXIE
- CRISTALLOPHYLLIENNES ROCHES
- PÉTROLOGIE
- TEXTURES, pétrographie
- RESTITES
- TECTONITES
- SCHISTOSITÉ
- ŒILLÉE TEXTURE
- RUBANÉE TEXTURE
- SANIDINE
- PHYLLADES
- DÉFORMATION DES ROCHES
- GLAUCOPHANE
- MÉTAMORPHISME RÉGIONAL
- RECRISTALLISATION
- MINÉRAUX NÉOFORMÉS
- MINÉRAUX RELIQUES
- INCLUSIONS SIGMOÏDES
- SCHISTEUSE TEXTURE
- LINÉAIRE TEXTURE
- CRISTALLOBLASTIQUE TEXTURE
- GRANULITES