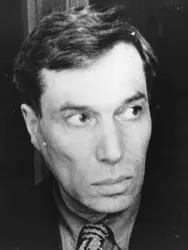SOVIÉTIQUE LITTÉRATURE DE GUERRE
Dans l'histoire des lettres soviétiques, la littérature de guerre proprement dite succède à la littérature de la guerre civile presque sans solution de continuité : Cholokhov publie le dernier livre du Don paisible en 1940 et La Science de la haine en 1942.
Le foisonnement de la littérature de guerre entre 1941 et 1945 relève du sentiment patriotique plus que de la création littéraire : il y a véritablement mobilisation spontanée des écrivains au service du pays. Ehrenbourg se consacre entièrement à la tâche de correspondant de guerre de la Krasnaïa Zvezda. Alexeï Tolstoï écrit Les Récits d'Ivan Soudarev (1941), et Cholokhov les premiers chapitres d'Ils ont combattu pour la patrie (1943-1944). La production de Constantin Simonov est particulièrement féconde : pièces de théâtre, reportages (dont un qui atteint les dimensions d'un livre : Les Jours et les nuits de Stalingrad, 1944) et surtout poésies, entre autres Attends-moi, que tous sauront par cœur. Ce qui est aussi le cas des chansons d'Alexis Sourkov (notamment La flamme palpite dans le poêle). À la radio de Leningrad affamée, la poétesse Olga Bergholtz appelle chaque jour la population à tenir bon. Pasternak, Anna Akhmatova, Marguerite Aliguer, Perets Markisch composent des poèmes de guerre. Écrivains combattants, Alexandre Bek (La Chaussée de Volokolamsk) et Vassili Grossman (Le peuple est immortel, 1942) continuent de publier. De cette littérature, qui se veut seulement de circonstance, une œuvre au moins est à retenir : le grand poème d'Alexandre Tvardovski Vassili Terkine, qui dut son immense popularité à la création d'une figure vraie de soldat russe.
La victoire ne met pas un terme à la floraison de la littérature de guerre. C'est au contraire le thème le plus abondamment traité dans la médiocre littérature de la fin de l'ère stalinienne, mais l'élan du cœur a fait place à une exaltation stéréotypée de l'héroïsme. Les conditions du moment ont valu à quelques-uns de ces livres une audience mondiale (ainsi l'Histoire d'un homme véritable de Boris Polevoï, mis en musique en 1948 par Serge Prokofiev). Deux seulement émergent pourtant, œuvres littéraires authentiques : la courte nouvelle intitulée L'Étoile (1917), d'un officier de commando, Emmanuel Kazakevitch ; plus encore Dans les tranchées de Stalingrad (1946), du lieutenant de sapeurs Viktor Nekrassov, le premier roman où la guerre apparaisse telle qu'elle fut.
Avec l'examen de conscience déclenché par les révélations du XXe congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, une troisième période commence pour la littérature de guerre. Dès 1955, Sergueï Smirnov entreprend un énorme travail de recherche pour ressusciter un haut fait jusque-là passé volontairement sous silence : la défense de la citadelle de Brest-Litovsk en 1941. Et vont se succéder des romans de valeur, où la guerre n'est plus prétexte à fanfares, mais quelque chose où l'on saigne, où l'on meurt et où l'homme n'est pas toujours beau à voir : Tête de pont (1959) et surtout L'Été 1941 (1968) de Baklanov ; Les Vivants et les Morts et On ne naît pas soldat (1963-1964) de Constantin Simonov ; Dernières salves (1959) de Bondarev ; Les morts ne souffrent pas (1966) de Bykov. Ce dernier, le plus intéressant des écrivains parlant de la guerre, poursuit sa quête morale en recherchant l'humain dans les conditions inhumaines de la guerre : Sotnikov (1970), La Meute de loups (1974), Aller sans retour (1978).
De plus en plus, les écrivains ont essayé d'élargir leur champ, de confronter la guerre avec le passé, comme Bykov dans son meilleur roman, Le Signe du malheur (1983), ou avec le présent comme Baklanov dans Le Frère cadet (1981) et Bondarev dans Le Rivage (1978). Malgré quelques audaces, ce roman marque la volonté[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean CATHALA : journaliste
Classification
Pour citer cet article
Jean CATHALA. SOVIÉTIQUE LITTÉRATURE DE GUERRE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Média
Autres références
-
AKHMATOVA ANNA (1889-1966)
- Écrit par Michel AUCOUTURIER
- 2 546 mots
...) qu'après 1941. La guerre l'a surprise à Leningrad, où elle assiste aux débuts du siège, avant d'être évacuée à Tachkent, en Asie centrale. Elle lui inspire des vers patriotiques où s'exprime l'inébranlable résolution d'un pays menacé dans son existence : ainsi, en 1942, le poème ... -
CHOLOKHOV MIKHAIL (1905-1984)
- Écrit par Jean PERROT
- 2 416 mots
La guerre de 1940 le déracine comme tant de millions de Soviétiques brassés par de gigantesques mouvements de population.Correspondant de presse, il est envoyé sur tous les fronts, et il compose une série d'articles, œuvres de publiciste, de 1941 à 1949 : Sur le Don, La Science de la haine... -
EHRENBOURG ILIA GRIGORIEVITCH (1891-1967)
- Écrit par Jean CATHALA
- 320 mots
Né à Kiev, mais Moscovite dès son plus jeune âge. Arrêté en 1907 pour activités subversives, Ehrenbourg va, après sa libération, s'établir à Paris, fréquente les révolutionnaires russes émigrés et les milieux littéraires parisiens ; il publie ses premiers vers, écrit ses premiers articles et rentre...
-
NEKRASSOV VIKTOR PLATONOVITCH (1911-1987)
- Écrit par Efim ETKIND
- 1 180 mots
Le futur auteur du roman Dans les tranchées de Stalingrad, alors jeune officier de l'Armée rouge, a été blessé en juillet 1944 ; il s'est mis à écrire ses souvenirs militaires pour exercer sa main droite paralysée. C'est dans la grande revue moscovite Znamia (Le Drapeau) que...
- Afficher les 8 références
Voir aussi