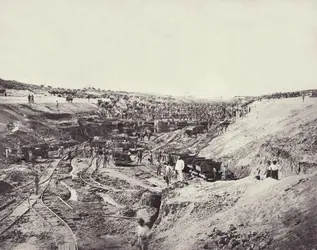ÉGYPTE L'Égypte coloniale
Les « siècles obscurs » qui commençaient, pour l'Égypte, en 1517, avec la conquête ottomane, s'achèvent brusquement, à la fin du xviiie siècle, par l'invasion de Bonaparte. Sous la domination des pachas turcs puis sous celle des beys mamelouks, le pays s'était progressivement appauvri et affaibli. L'admirable système d'irrigation, faute d'entretien, se dégradait, entraînant la ruine de l'agriculture et du commerce. Désormais, à la fin du xviiie siècle, les ressources de l'économie égyptienne servent moins à la prospérité du pays qu'aux besoins d'une poignée de dirigeants mamelouks préoccupés de leurs luttes locales ou personnelles. Les institutions politiques affaiblies par la décadence du pouvoir central s'effondrent au premier choc.
Épuisée par les divisions intestines et par le gaspillage de ses ressources, l'Égypte se trouve incapable de résister, en 1799, à l'invasion française. Après le long déclin qui la précède, celle-ci marque un tournant dans l'histoire du pays qu'elle fait entrer dans la « modernité ». L'Égypte abandonne alors un système politique et économique médiéval et tente de s'adapter aux progrès de l'histoire, activement, audacieusement, sous Muḥammad ‘Alī et Ismā‘īl, avec des à-coups et des reculs durant les autres règnes. Elle se heurte à des difficultés considérables, nées certes de l'amplitude des clivages, mais surtout du caractère « importé » des idées nouvelles et des techniciens dans un pays où l'Islam est profondément mêlé à la vie politique et quotidienne, cela au moment même des pressions puis de l'occupation étrangères. On va donc assister à un progrès matériel et technique plus rapide que le développement intellectuel et culturel du pays, d'où une résistance émotionnelle des esprits à la culture moderne, un attachement à la tradition et le sentiment d'une continuité dans la lutte séculaire contre l'ennemi chrétien. D'où aussi la diffusion, au milieu du xixe siècle, des idées pan-islamiques d'un Djamāl al-Dīn al-Afghānī et d'un Muḥammad ‘Abduh, favorisée par la foi des masses d'émigrants ruraux venus dans les villes. L'emprise religieuse assure celle de la tradition et s'oppose aux nouvelles conceptions des rapports humains. Avec l'arrivée des Français, l'heure des choix a sonné, aisés dans la révolte populaire contre l'envahisseur français ou anglais, de plus en plus délicats quand devra se décider, dans la stabilisation d'une semi-indépendance, l'avenir politique et économique du pays.
L'occupation française
L'armée, dirigée par Bonaparte, débarque le 1er juillet 1798 à Aboukir. La jeune République française voit en l' Égypte moins, peut-être, une colonie à exploiter qu'une carte à jouer dans la guerre qui l'oppose à l'Angleterre. Bonaparte, ambitieux et encore imprégné d'idéal révolutionnaire, aspire à suivre l'exemple des grands conquérants, mais aussi à régénérer cette « terre antique ». Il amène avec son armée une équipe ardente de savants chargés de doter le pays de techniques modernes et de faire œuvre civilisatrice. La destruction de sa flotte par Nelson, à Aboukir, le coupe de la métropole et le contraint à ne compter que sur lui-même. Il organise l'administration selon des principes européens et en faisant appel à une représentation populaire. Un conseil général (al-dīwān al-‘āmm), formé d'ulémas, de notables et de commerçants délégués des diverses provinces, coiffe les conseils régionaux et se trouve chargé de « trancher des affaires du pays ». Mais les initiatives du conseil, sous l'impulsion des Français qui, par souci d'équité, tentent de mieux répartir la charge de l'impôt foncier en exigeant des titres de propriété souvent inexistants parce que la propriété[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Nada TOMICHE : agrégée, docteur ès lettres, professeur des Universités, professeur à l'université de Paris-III-Sorbonne nouvelle
Classification
Pour citer cet article
Nada TOMICHE. ÉGYPTE - L'Égypte coloniale [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Voir aussi
- ISRAÉLO-ARABE CONFLIT
- NEUTRALITÉ
- WAFD, parti égyptien
- SA‘ĪD (1822-1863) vice-roi d'Égypte (1854-1863)
- KHÉDIVE
- IBRĀHĪM (1789-1848) vice-roi d'Égypte (1848)
- ISMĀ‘ĪL (1830-1895) khédive d'Égypte (1867-1879)
- ZAGHLŪL PACHA SA‘D (1860-1927)
- ÉGYPTE, histoire : de 639 à 1805
- ÉGYPTE, histoire : de 1805 à 1952
- SYRIE, histoire jusqu'en 1941
- BRITANNIQUE EMPIRE, Afrique