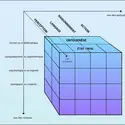PRAGMATIQUE
L'exemple du dialogue référentiel
Pour tester la suffisance des concepts ainsi dégagés, Jacques a construit (1979) un modèle simple de dialogue référentiel, espèce du dialogue en quête d'information décrit par Hintikka (1980) sur la base de la logique modale quantifiée et de la logique des questions. Le dialogue référentiel doit permettre de comprendre comment il est possible alors de concilier le jeu des conditions de vérité d'une séquence d'énoncés en contexte interlocutif avec le jeu des conditions de succès des énonciations correspondantes. Le dialogue référentiel est défini comme le contexte minimal d'analyse. Il présente une situation linguistique où le thème débattu concerne l'existence et l'identification d'un référent. Les interlocuteurs se demandent en définitive : qui, quand, quoi, où... F(x) ? [où x est l'individu cherché et F un prédicat]. À tout moment de l'entretien, l'information pragmatiquement pertinente est assertée sur un arrière-plan de présuppositions rendues communes. Voici les distinctions opératoires :
1o on distingue entre modalités d'énoncé, qui déterminent comment ce qui est dit est situé par rapport à la vérité et à la certitude, et les modalités d'énonciation, c'est-à-dire les actes de langage. Distinction fonctionnelle, puisque l'élaboration des premières ne s'opère que par l'interaction des secondes : assertions, objections, questions et réponses.
2o la progression du dialogue comporte, par conséquent, deux aspects indissociables : un aspect selon lequel les attitudes propositionnelles sont confrontées au sujet du référent et, par ailleurs, un aspect selon lequel les actes de langage réalisent cette confrontation.
3o ce sont les mêmes actes de langage qui alternent dans le dialogue au titre de leur valeur illocutoire et qui, par leurs effets perlocutoires, tendent à modifier les attitudes propositionnelles et à les confronter.
4o les traits du contexte contribuant à déterminer le contenu du message sont, pour un certain nombre, les mêmes qui servent à décrire les effets perlocutoires. Intervenant à double titre, les traits contextuels devraient relever d'une théorie unique.
5o encore faut-il que les actes de langage soient ordonnés, dans le procès du dialogue, entre eux et par rapport à l'objectif référentiel. Parmi les règles pragmatiques qui régissent la séquence des énonciations, on peut en rapporter certaines au titre de règles structurales, car elles régissent l'interaction linguistique, certaines autres au titre de règles stratégiques, car elles permettent de relier sémantiquement les énoncés exprimés aux diverses étapes du dialogue.
Ce modèle s'efforce de prendre en compte certaines données de la linguistique française dite de l'énonciation. Il montre que des notions centrales de la pragmatique logique comme la vérité ou la référence, ne peuvent être établies en dehors d'une situation pragmatique. Le réel ne se manifeste pas dans sa vérité sans être l'objet d'une communication. Dans la mesure où le modèle est opératoire, on parvient à dépasser l'opposition jusque-là spéculative entre la manifestation du réel et la communication du vrai.
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Francis JACQUES : professeur à l'université de Rennes
Classification
Pour citer cet article
Francis JACQUES. PRAGMATIQUE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Autres références
-
ACQUISITION DE LA PRAGMATIQUE DU LANGAGE
- Écrit par Josie BERNICOT
- 1 254 mots
L’acquisition de la pragmatique du langage (S. Ervin-Tripp) correspond à l’acquisition des usages du langage considérés du point de vue cognitif, social et culturel. Les recherches sont réalisées dans le cadre théorique de la philosophie du langage. Tout énoncé est considéré comme un acte...
-
COGNITIVES SCIENCES
- Écrit par Daniel ANDLER
- 19 262 mots
- 4 médias
...syntaxique et sémantique, malgré leur caractère absolument central dans l'étude du langage, et choisissons notre deuxième exemple dans le domaine de la pragmatique. La question est ici celle de la compréhension d'un message dont l'analyse phonologique, syntaxique et sémantique est accomplie, fournissant... -
CROYANCE
- Écrit par Paul RICŒUR
- 11 987 mots
...concentre sur la valeur de vérité des énoncés. G. Frege en est le fondateur, avec sa distinction fameuse entre sens et référence (ou dénotation). Les énonciations relèvent de la pragmatique, dont une des tâches est de rendre compte des changements de sens et de référence des propositions en fonction... -
ÉNONCÉ, linguistique
- Écrit par Catherine FUCHS
- 1 329 mots
En linguistique, un énoncé peut être défini comme une séquence orale ou écrite résultant d'un acte d'énonciation, c'est-à-dire produite par un sujet énonciateur dans une situation donnée. En français, la phrase minimale comporte nécessairement au moins un sujet et un verbe conjugué....
-
GRAMMAIRES COGNITIVES
- Écrit par Catherine FUCHS
- 1 352 mots
Couvrant un champ plus vaste qui s'étend jusqu'à la pragmatique, la théorie proposée par G. Fauconnier (Espaces mentaux, 1984) vise à décrire la dynamique d'élaboration et d'altération des configurations cognitives (« espaces mentaux ») construites au fil du discours. Ainsi l'énoncé... - Afficher les 22 références
Voir aussi