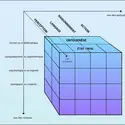PRAGMATIQUE
Plusieurs pragmatiques ?
Le plus expédient paraît être de classer les études pragmatiques en fonction du type de contexte, le contexte étant un concept central et caractéristique, ainsi que le pense H. Parret (1983).
Le co-texte
Alors que la syntaxe ne transcende jamais la phrase et que la sémantique, dans ses versions linguistique ou logique, tente de se restreindre à la proposition, plusieurs recherches pragmatiques offrent des techniques pour analyser de grandes unités du discours. C'est le cas de la grammaire textuelle, qui s'attache aux formes dégagées sur des « textes » entiers dont les unités constitutives ne sont plus des mots ni même des propositions. Celles-ci sont alors considérées comme simples « indices » d'un certain fonctionnement d'une grande unité, selon Ducrot (1980). De même les relations découvertes par l'analyse du discours ou l'analyse conversationnelle portent sur des fragments discursifs ou argumentatifs. Elles excèdent le lien anaphorique entre phrases ou le lien co-référentiel entre propositions. Le co-texte, une fois restitué dans sa cohésion et sa combinatoire propres, permet à l'interprète de découper les macro-unités qu'il s'efforce de comprendre. Mais il paraît indispensable de mettre en rapport les systèmes macro-grammaticaux avec d'autres types de contextualité que ceux qui sont pris en compte par la pragmatique des grandes unités.
Le contexte référentiel
Avec lui, on aborde la pragmatique des philosophes-logiciens. Ce sont eux qui ont montré que les séquences de signes prennent sens par rapport à leurs référents : le monde des objets et des états des choses. Le souci qu'ils ont de la référence extra-linguistique les oppose aux diverses versions du structuralisme français, pour lesquelles le sens est immanent. Cette pragmatique référentielle, très développée, est en voie de s'intégrer dans certains aspects de la linguistique de l'énonciation. Une de ses parties est la pragmatique indexicale, chronologiquement première. On passe de la sémantique à la pragmatique dès lors que les agents concrets de la communication et leur localisation spatio-temporelle sont tenus pour des indices du contexte existentiel. Pour Montague (1974), la pragmatique indexicale pourrait rester véri-fonctionnelle. On relierait peu à peu les phénomènes grammaticaux de la personne, de la modalité, du mode, du temps et de l'aspect, aux indices référentiels. Il est à noter que la théorie des modèles et la logique modale élaborent un cadre de mondes possibles où les expressions linguistiques se voient assigner un domaine. Logiciens et linguistes semblent se rapprocher pour faire entrer dans la pragmatique indexicale toute partie de la description linguistique qui met en place un métalangage comportant des symboles pour les interlocuteurs, le temps, le lieu, et aussi le symbole « dire ». Ainsi Wunderlich (1972) et Grunig (1981).
Le contexte situationnel
À la différence du précédent, ce contexte n'est que partiellement exprimé par les séquences linguistiques. Les situations sont médiatisées culturellement, reconnues socialement. Elles font partie de la classe des déterminants sociaux. Une célébration liturgique, une négociation salariale, une discussion entre parlementaires, un assaut de mauvaises plaisanteries, une plaidoirie au tribunal, certaines routines quotidiennes à forme fixe déterminent en grande partie soit les structures argumentatives, soit les propriétés conversationnelles de grandes unités textuelles. Les socio-linguistes se sont affrontés au problème typologique. La classe des situations est virtuellement infinie et les pratiques discursives aussi nombreuses que les jeux de langage wittgensteiniens. Faut-il construire la typologie sur la notion du rôle que peuvent jouer les participants (à condition de pouvoir définir celui-ci comme la plus petite unité sociale dérivée d'un[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Francis JACQUES : professeur à l'université de Rennes
Classification
Pour citer cet article
Francis JACQUES. PRAGMATIQUE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Autres références
-
ACQUISITION DE LA PRAGMATIQUE DU LANGAGE
- Écrit par Josie BERNICOT
- 1 254 mots
L’acquisition de la pragmatique du langage (S. Ervin-Tripp) correspond à l’acquisition des usages du langage considérés du point de vue cognitif, social et culturel. Les recherches sont réalisées dans le cadre théorique de la philosophie du langage. Tout énoncé est considéré comme un acte...
-
COGNITIVES SCIENCES
- Écrit par Daniel ANDLER
- 19 262 mots
- 4 médias
...syntaxique et sémantique, malgré leur caractère absolument central dans l'étude du langage, et choisissons notre deuxième exemple dans le domaine de la pragmatique. La question est ici celle de la compréhension d'un message dont l'analyse phonologique, syntaxique et sémantique est accomplie, fournissant... -
CROYANCE
- Écrit par Paul RICŒUR
- 11 987 mots
...concentre sur la valeur de vérité des énoncés. G. Frege en est le fondateur, avec sa distinction fameuse entre sens et référence (ou dénotation). Les énonciations relèvent de la pragmatique, dont une des tâches est de rendre compte des changements de sens et de référence des propositions en fonction... -
ÉNONCÉ, linguistique
- Écrit par Catherine FUCHS
- 1 329 mots
En linguistique, un énoncé peut être défini comme une séquence orale ou écrite résultant d'un acte d'énonciation, c'est-à-dire produite par un sujet énonciateur dans une situation donnée. En français, la phrase minimale comporte nécessairement au moins un sujet et un verbe conjugué....
-
GRAMMAIRES COGNITIVES
- Écrit par Catherine FUCHS
- 1 352 mots
Couvrant un champ plus vaste qui s'étend jusqu'à la pragmatique, la théorie proposée par G. Fauconnier (Espaces mentaux, 1984) vise à décrire la dynamique d'élaboration et d'altération des configurations cognitives (« espaces mentaux ») construites au fil du discours. Ainsi l'énoncé... - Afficher les 22 références
Voir aussi