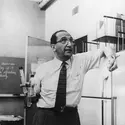LYSOGÉNIE
Depuis 1940, et sous l'impulsion de Max Delbrück, les bactériophages ont donné lieu à de nombreuses recherches qui ont apporté beaucoup d'explications sur l'origine, l'action et la reproduction des virus, et sur un grand nombre d'autres problèmes qui touchent la bactériologie, la génétique, la biologie générale, la cancérologie.
Un aspect particulier de la bactériophagie fera l'objet de cet article : la lysogénie. « Une bactérie lysogène, a écrit André Lwoff, est une bactérie qui possède et transmet le pouvoir de produire du bactériophage » en l'absence d'infection directe, et de le mettre en liberté, sous certaines conditions et en quantités extrêmement variables, dans le milieu de culture où elle se multiplie. On a successivement donné les noms de lysogénéité (en anglais : lysogenicity) puis de lysogénie à ce très curieux caractère. Alors que l'infection par des bactériophages virulents conduit inéluctablement à la mort des bactéries, la lysogénisation est apparemment inoffensive pour celles qui la subissent.
Histoire de la notion de lysogénie Proposition de F. W. Twort
En 1915, Frederick William Twort décrit la transformation vitreuse de certaines cultures bactériennes. Cette véritable maladie des bactéries est transmissible d'une culture atteinte à une culture saine de la même espèce et son agent est comparable aux virus ultramicroscopiques des maladies de l'homme, des animaux et des végétaux supérieurs.
Il s'interroge alors sur la nature de ces virus. Entre diverses hypothèses proposées, il envisage celle d'un matériel autodestructeur dont les effets seraient comparables au processus cancéreux, évoquant implicitement la présence d'un virus à l'état latent dans les cellules destinées à subir éventuellement à plus ou moins longue échéance le développement anarchique caractéristique de cette maladie.
Proposition de Félix d'Hérelle
Pour Félix d'Hérelle, qui redécouvre en 1917 la lyse bactérienne transmissible, à laquelle il donne le nom de bactériophagie, les cultures secondaires à cette analyse entretiennent indéfiniment le bactériophage en formant avec lui une association symbiotique, dont on verra plus loin qu'elle comprend deux états bien différents.
La théorie de Jules Bordet
La conception virale du bactériophage admise dès le début par Twort et par d'Hérelle est alors contestée par plusieurs auteurs parmi lesquels T. Kabeshima et Jules Bordet. Selon ce dernier, le bactériophage n'existerait pas. La lyse transmissible serait due à une viciation nutritive provoquée dans la bactérie par des causes extérieures. Ainsi, à la suite d'injections intrapéritonéales répétées de Bacterium coli à des cobayes, l'exsudat formé est riche en leucocytes et provoquerait une anomalie de B. coli qui ne serait que l'exagération, devenue héréditaire, du processus physiologique, et non héréditaire, d' autolyse. Cette propriété nouvelle serait donc inscrite désormais dans l' hérédité de la bactérie, d'où son double caractère : transmissible, de bactérie mère à bactéries filles, et contagieux, de bactéries sœurs à bactéries sœurs.
Si les travaux ultérieurs n'ont pas confirmé la conception de la viciation nutritive proposée par Bordet, on doit à cet auteur en premier lieu l'expression de bactéries lysogènes, d'où est venue tout naturellement celle de lysogénéité et surtout la notion capitale d'hérédité et de facteur lysogène. En effet, comme Lwoff l'a très judicieusement fait remarquer, la lysogénie occupe une position privilégiée au croisement de l'hérédité normale et de l'hérédité pathologique.
La conception de F. M. Burnet
Plus tard, F. M. Burnet, après avoir démontré l'existence des corpuscules bactériophages de d'Hérelle (ou[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre NICOLLE : docteur en pharmacie et en médecine, chef de service honoraire à l'Institut Pasteur
Classification
Pour citer cet article
Pierre NICOLLE. LYSOGÉNIE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
BACTÉRIOPHAGES ou PHAGES
- Écrit par Jean-François VIEU
- 3 521 mots
- 1 média
...l'ADN bactériophagique dans le cytoplasme bactérien n'induit pas obligatoirement l'établissement d'un cycle lytique de multiplication du bactériophage ; la bactérie peut survivre, acquérir et transmettre à sa descendance la propriété héréditaire de produire des phages en l'absence d'infection directe ;... -
JACOB FRANÇOIS (1920-2013)
- Écrit par Universalis, François GROS
- 1 387 mots
- 1 média
Lauréat du prix Nobel de physiologie ou médecine en 1965, le Français François Jacob fut une figure majeure de la génétique et de la biologie moléculaire.
François Jacob naît le 17 juin 1920 à Nancy. En 1940, alors qu’il a entamé des études de médecine à Paris, il n’accepte pas la capitulation...
-
LYSOTYPIE
- Écrit par Pierre NICOLLE
- 400 mots
Si l'on fait agir un bactériophage convenablement choisi et dilué sur diverses cultures d'une même espèce bactérienne ou d'un même sérotype, on constate souvent, surtout si ces cultures ont été isolées en des endroits géographiquement éloignés les uns des autres ou à partir d'espèces animales différentes,...
-
VIROLOGIE
- Écrit par Sophie ALAIN, Michel BARME, François DENIS, Léon HIRTH
- 10 458 mots
- 7 médias
...« prophage », selon l'appellation proposée par A. Lwoff, est fournie par les expériences d'induction : les bactéries contenant le prophage (bactérie lysogène), traitées par les rayons ultraviolets ou des substances chimiques appropriées, libèrent le prophage qui se réplique alors et donne naissance...
Voir aussi