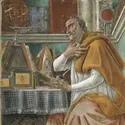HERMÉNEUTIQUE
- 1. Une pensée de la compréhension
- 2. L'équité herméneutique et les exigences de l'interprétation (F. G. Meier).
- 3. Le perspectivisme des interprétations et l'objectivité de la connaissance (J. M. Chladenius)
- 4. L'herméneutique comme art philosophique universel (F. Schlegel)
- 5. L'herméneutique et la vie de l'esprit universel (F. Ast)
- 6. La circularité herméneutique (F. Schleiermacher)
- 7. La fondation philosophique de l'herméneutique (W. Dilthey)
- 8. La compréhension comme modalité de l'être-au-monde (M. Heidegger)
- 9. La fécondité herméneutique de la distance temporelle (H.-G. Gadamer)
- 10. « Expliquer plus, c'est comprendre mieux » (P. Ricœur)
- 11. Bibliographie
L'herméneutique comme art philosophique universel (F. Schlegel)
À partir du xixe siècle, l'herméneutique se déplace de plus en plus du problème « technique » de l'interprétation vers le problème, philosophiquement plus fondamental, de la compréhension. Ce changement de paradigme a rendu possible l'émergence d'une herméneutique philosophique, puis, à partir du début du xxe siècle, d'une philosophie herméneutique qui se développe dans le sillage de la phénoménologie husserlienne.
Sans le travail considérable visant à l'appropriation de la philosophie platonicienne, inséparable d'un travail d'édition et de traduction, cette percée n'aurait probablement jamais pu se produire. S'inspirant des thèses de F. A. Wolf (1759-1824) sur Homère, F. von Schlegel (1772-1829) rêve à une « philosophie progressive de la philologie », qui serait en quête de la compréhension absolue. Les œuvres vivantes de l'esprit n'étant jamais définitivement achevées, leur compréhension représente une tâche infinie. Toute œuvre parfaite « en sait plus long qu'elle ne dit et veut plus que ce qu'elle sait ». Comprendre le sens d'une œuvre suppose une certaine capacité divinatoire qui prolonge l'œuvre.
- 1. Une pensée de la compréhension
- 2. L'équité herméneutique et les exigences de l'interprétation (F. G. Meier).
- 3. Le perspectivisme des interprétations et l'objectivité de la connaissance (J. M. Chladenius)
- 4. L'herméneutique comme art philosophique universel (F. Schlegel)
- 5. L'herméneutique et la vie de l'esprit universel (F. Ast)
- 6. La circularité herméneutique (F. Schleiermacher)
- 7. La fondation philosophique de l'herméneutique (W. Dilthey)
- 8. La compréhension comme modalité de l'être-au-monde (M. Heidegger)
- 9. La fécondité herméneutique de la distance temporelle (H.-G. Gadamer)
- 10. « Expliquer plus, c'est comprendre mieux » (P. Ricœur)
- 11. Bibliographie
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean GREISCH : docteur en philosophie, professeur émérite de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris, titulaire de la chaire "Romano Guardini" à l'université Humboldt de Berlin (2009-2012)
Classification
Pour citer cet article
Jean GREISCH. HERMÉNEUTIQUE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
AU DÉTOUR DU SENS. PERSPECTIVES D'UNE PHILOSOPHIE HERMÉNEUTIQUE (C. Berner) - Fiche de lecture
- Écrit par Jean GREISCH
- 971 mots
Au cours du xxe siècle, la philosophieherméneutique s'est développée selon deux axes distincts : le premier se laisse guider par le concept de compréhension qui, tant chez Heidegger que chez Gadamer, ne désigne plus un mode de connaître, mais une manière d'être ; le second, suivi en France...
-
ALLÉGORIE
- Écrit par Frédéric ELSIG, Jean-François GROULIER, Jacqueline LICHTENSTEIN, Daniel POIRION, Daniel RUSSO, Gilles SAURON
- 11 594 mots
- 5 médias
-
ARISTOTE (env. 385-322 av. J.-C.)
- Écrit par Pierre AUBENQUE
- 23 786 mots
- 2 médias
Dans les interprétations les plus récentes de l'œuvre aristotélicienne, deux courants s'affrontent : le courant herméneutique et le courant analytique. Le premier, dominant chez les interprètes d'Europe continentale, s'intéresse au contexte linguistique et historique, à l'architecture... -
BĀṬIN & BĀṬINIYYA
- Écrit par Joseph CUOQ
- 356 mots
Le mot arabe bāṭin signifie « caché », « ésotérique », par opposition à ẓāhir qui est traduit par « explicite », « obvie », « littéral ». La distinction entre bāṭin et ẓāhir intervient dans l'interprétation du Coran, lequel, au-dessus du sens explicite...
-
BIBLE - L'inspiration biblique
- Écrit par André PAUL
- 4 564 mots
- 1 média
L'Égypte ancienne, déjà, attribuait ses « saintes écritures » au dieu écrivain ou scribe Thot, le précurseur d'Hermès. Proche de cette figure égyptienne, il y avait aussi, et surtout, le dieu babylonien Nabû, fils de Marduk : considéré comme le scribe par excellence, on l'appelait le « scribe des dieux... - Afficher les 42 références
Voir aussi