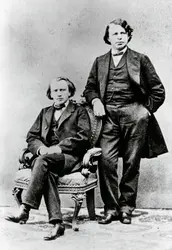FUGUE
« La fugue (de fuga, fuite) est une forme de composition musicale dont le thème, ou sujet, passant successivement dans toutes les voix, et dans diverses tonalités, semble sans cesse fuir. » Ainsi Marcel Dupré définit-il la fugue. La fugue est fille du contrepoint, qui a atteint son apogée au xvie siècle. Empruntant les voies de l'imitation, du canon et du ricercare, elle naît de l'évolution de l'écriture polyphonique et contrapuntique.
Le contrepoint consiste essentiellement à conduire simultanément plusieurs lignes mélodiques. L'imitation est une forme de contrepoint qui reproduit les mêmes motifs mélodiques ou rythmiques, à une ou plusieurs voix, sur les différents degrés de la gamme. Le canon est une imitation rigoureuse, et, au départ, la fugue développe un canon à la quinte. Quant au ricercare, il est construit sur le principe d'une imitation contrapuntique libre ; il n'a pas les structures complexes et imposées de la fugue ; il est plus un genre qu'une forme.
Trois lois fondamentales régissent l'art de la fugue classique. Alors que le contrepoint du xvie siècle a un caractère modal, la fugue est soumise aux impératifs de l'unité tonale majeure ou mineure. Par opposition à ce que seront la sonate et la symphonie, elle conserve une unité rythmique et une unité thématique. Le sujet d'une fugue, contrairement au thème de la sonate, est toujours exposé, jamais développé.
Forme rigoureuse par excellence, dont l'élément mélodique initial contient en puissance la structure même de l'œuvre, la fugue est une remarquable matière à improvisation, que les organistes et les clavecinistes ont toujours particulièrement appréciée. Dans la technique dodécaphonique atonale, il est possible d'écrire des fugues en imitation contrapuntique rigoureuse. Mais aucun musicien n'a jamais dépassé Jean-Sébastien Bach, qui a porté l'art de la fugue au summum de la rigueur, de la souplesse et de la variété, pour la plus grande joie de l'esprit et le plaisir de l'oreille.
Du contrepoint à la fugue
Toute l'histoire de la musique occidentale repose sur l'équilibre permanent qu'on y rencontre entre l'écriture horizontale et l'écriture verticale, entre le contrepoint et l'harmonie. Le contrepoint est antérieur à l'harmonie, puisque la musique du haut Moyen Âge était exclusivement monodique et que le contrepoint est né par hasard, le jour où un musicien a eu l'idée de faire exécuter ensemble deux monodies et par là même de régenter les rapports de ces lignes entre elles. Ensuite, d'autres lignes mélodiques se sont ajoutées aux deux premières : la simultanéité de leur exécution offrait à chaque moment, à l'oreille, un ensemble de notes constitutives d'un accord, et l'harmonie existait de ce fait même. Ainsi, l'harmonie découpe verticalement le matériau musical offert par les hasards calculés du contrepoint.
Le contrepoint n'est nullement une « forme » musicale. C'est un style d'écriture, qui met au-dessus de tout l'indépendance et l'originalité de chacune des parties réelles de la partition. La notion de forme n'intervient qu'à partir du moment où le musicien cherche à compliquer le jeu et à y introduire des conventions arbitraires supplémentaires. C'est le cas du canon. Ce dernier constitue la forme la plus stricte de l'imitation. Lorsqu'une phrase énoncée par une partie est reprise par une autre, mais sur un autre degré de l'échelle musicale, il y a imitation. Lorsque la première et la seconde partie énoncent la même phrase simultanément, mais avec un décalage marqué, il y a canon. La partie proposante s'appelle « antécédent », la ou les parties qui imitent se nomment « conséquent ». La chanson enfantine Frère Jacques est le type le[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- PIERRE-PETIT : directeur de l'École normale de musique de Paris, critique musical, directeur musical à R.T.L.
- Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis
Classification
Pour citer cet article
Universalis et PIERRE-PETIT. FUGUE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )
Médias
Autres références
-
BUXTEHUDE DIETRICH (1637 env.-1707)
- Écrit par Marc VIGNAL
- 943 mots
Longtemps revendiqué par l'Allemagne et par le Danemark, Buxtehude naît dans une portion du Holstein alors danoise mais qui plus tard deviendra (et restera) allemande ; il passera les trente premières années de sa vie au Danemark (en n'y composant qu'une seule œuvre) et les quarante dernières...
-
COMPOSITION MUSICALE
- Écrit par Michel PHILIPPOT
- 6 846 mots
- 2 médias
...chronologique. On se contentera ici d'apporter une attention particulière aux deux schèmes formels les plus classiques, c'est-à-dire les plus intégrés à l'histoire de la musique occidentale, la fugue et la sonate ; au passage, on s'attardera sur tous ceux qui en dérivent ou qui permirent de les constituer. -
Fantaisie et fugue en ut mineur, BACH (Carl Philipp Emannuel)
- Écrit par Alain FÉRON
- 552 mots
Maître de la musique instrumentale, Carl Philipp Emanuel Bach, deuxième fils de Jean-Sébastien Bach, donne avec son Essai sur la véritable manière de jouer des instruments à clavier (deux volumes : 1753, 1762) un traité qui va durablement influencer l'évolution de la musique occidentale et... -
FRESCOBALDI GIROLAMO (1583-1643)
- Écrit par Philippe BEAUSSANT
- 509 mots
L'une des figures les plus marquantes du premier âge baroque en Italie. Élève de Luzzasco Luzzaschi à Ferrare, sa carrière semble avoir été précoce : dès 1604, Frescobaldi est organiste et cantor de la congrégation Sainte-Cécile à Rome. Après un court voyage en Flandre avec le nonce (il publie...
- Afficher les 11 références
Voir aussi