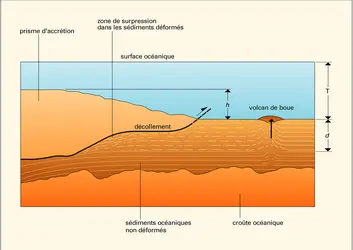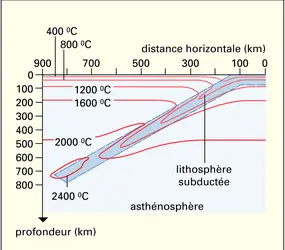FLUX GÉOTHERMIQUE
Articles
-
DORSALES OCÉANIQUES
- Écrit par Jean FRANCHETEAU
- 5 389 mots
- 10 médias
La circulation hydrothermale au centre des dorsales transporte environ 30 p. 100 du flux de chaleur d'origine interne vers la surface du globe. Elle est à la base de flux importants d'éléments entre la croûte et l'océan. Pendant longtemps, l'écart entre le flux de chaleur par conduction mesuré dans les... -
ÉNERGIES RENOUVELABLES
- Écrit par Daniel CLÉMENT
- 15 637 mots
- 22 médias
La géothermie exploite le flux de chaleur naturellement présent à l’intérieur du globe terrestre pour l’utiliser comme source de chaleur ou pour produire de l’électricité. La température du sous-sol augmente partout avec la profondeur, d’environ 3 0C tous les cent mètres (on parle de... -
GÉODYNAMIQUE
- Écrit par Jean GOGUEL
- 3 412 mots
...l'intensité de ses manifestations, il apporte beaucoup moins de chaleur à la surface (0,001 6 W . m-2, soit une puissance globale de 8 . 108 kW) que le flux géothermique qui se manifeste sur toute la surface de la Terre, avec une intensité légèrement variable, mais dont la valeur moyenne, 0,082 watt par... -
LITHOSPHÈRE
- Écrit par Marc DAIGNIÈRES, Adolphe NICOLAS
- 6 968 mots
- 10 médias
...directement dépendante du géotherme (profil de température en fonction de la profondeur). Celui-ci est régionalement estimé à partir des valeurs mesurées du flux de chaleur en surface (variant de 40 mW. m-2 pour les boucliers précambriens, à plus de 120 mW. m-2 dans certains domaines océaniques), et... -
OCÉAN ET MERS (Géologie sous-marine) - Étude des fonds sous-marins
- Écrit par Gérard GRAU, Lucien MONTADERT, Claude SALLÉ
- 4 258 mots
- 6 médias
Ce n'est qu'à partir de 1952 que E. C. Bullard et ses collaborateurs ont commencé à mesurer le flux de chaleur à travers le fond de la mer. La conclusion la plus importante, et aussi la plus surprenante, de ces études a été qu'en moyenne il n'y a pas de différence marquée entre continents et océans... -
SUBDUCTION
- Écrit par Jean AUBOUIN
- 6 289 mots
- 9 médias
Les fosses ont été caractérisées par un déficit du flux de chaleur qui est attribué à la plongée de la lithosphère océanique froide dans l' asthénosphère plus chaude (fig. 5). Elles s'opposent ainsi aux zones d' accrétion océanique, caractérisées par un fort flux de chaleur lié à la remontée de l'asthénosphère.... -
SUBSIDENCE, géologie
- Écrit par Marie-Françoise BRUNET
- 2 216 mots
- 1 média
Un grand pas dans la compréhension des origines de la subsidence a été franchi avec l'étude des relations de la décroissance du flux thermique et de l'approfondissement des bassins océaniques avec l'âge, selon une courbe de refroidissement à allure exponentielle (constante de temps : 62,8 Ma ; Barry...
Médias